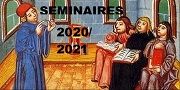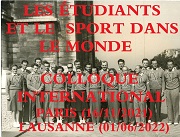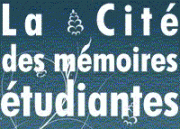-
AGENDA
Il n'y a aucun événement à venir.
CHAINE YOUTUBE DE LA CITE
SEMINAIRES
COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE
Catégories
- appel à contributions
- archives et mémoires
- axes de recherche
- cahiers du germe
- collection germe aux éditions Syllepse
- dans d'autres éditions
- dictionnaire biographique et prosopographie
- internationale
- La lettre électronique
- mouvement étudiant et jeunesse
- mouvement étudiant et milieu étudiant
- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société
- mouvements étudiants et institution universitaire
- Non classé
- notes de lecture
- séminaires
- vie du germe
Étudier les mouvements étudiants
Les « blokade » en Serbie : une mobilisation étudiante qui transforme radicalement la société
 (Article publié sur Meridiano 13 le 16 mai 2025 par Aïda Kapetanović *). Depuis six mois maintenant, les étudiants et étudiantes de Serbie mènent un mouvement qui est en train de réécrire l’histoire du pays. Une mobilisation qui a impliqué des milliers de citoyens, différents secteurs de la société, qui a conduit à la démission du Premier ministre et qui met à rude épreuve le régime d’Aleksandar Vučić.
(Article publié sur Meridiano 13 le 16 mai 2025 par Aïda Kapetanović *). Depuis six mois maintenant, les étudiants et étudiantes de Serbie mènent un mouvement qui est en train de réécrire l’histoire du pays. Une mobilisation qui a impliqué des milliers de citoyens, différents secteurs de la société, qui a conduit à la démission du Premier ministre et qui met à rude épreuve le régime d’Aleksandar Vučić.
Tout a commencé le 1er novembre 2024, lorsque l’effondrement de l’auvent de la gare de Novi Sad a fait 15 morts, un bilan qui est passé à 16 dans les mois suivants. L’auvent avait récemment fait l’objet de travaux de rénovation, confiés à des entreprises de construction proches du gouvernement, dans le cadre d’un projet plus large de modernisation des infrastructures ferroviaires promu par le gouvernement chinois. Bien que les travaux de rénovation aient été présentés au public dès la campagne électorale de 2022, la reconstruction s’est poursuivie jusqu’en juillet 2024, date à laquelle les autorités ont déclaré qu’elle était achevée « conformément aux normes européennes ».
L’absence de prise de responsabilité de la part des institutions après l’effondrement de l’auvent et le refus d’ouvrir une enquête sur les travaux de rénovation ont fait de cette tragédie le symbole le plus emblématique de la négligence institutionnelle et du système de corruption généralisé dans le pays. Un système qui imprègne les niveaux les plus profonds des institutions serbes et qui voit à sa tête le président Vučić et son Parti progressiste serbe (SNS), au pouvoir depuis 2012.
Avec le slogan « la corruption tue », les étudiants et étudiantes ont réagi en transformant la tragédie en mobilisation. Des blocages quotidiens ont paralysé les principales villes, marqués par quinze minutes de silence en mémoire des victimes de Novi Sad. Alors que les protestations s’intensifiaient de jour en jour, les autorités ont réagi en tentant de les réprimer, tant par le biais de la police que par des pratiques informelles, telles que des violences, des agressions physiques et des tentatives de renverser les manifestants.
C’est précisément l’une de ces agressions, perpétrée le 22 novembre contre des étudiants et des professeurs de la Faculté des arts dramatiques de Belgrade qui manifestaient, qui a provoqué l’escalade de la mobilisation. Réunis dans leur faculté, les étudiants ont lancé le 25 novembre la première blokada, c’est-à-dire le blocage des activités universitaires et l’occupation de l’université.
Les blokade et les plenum
Le blocage de la faculté des arts dramatiques de Belgrade a eu un effet domino immédiat, touchant aujourd’hui la quasi-totalité des universités du pays. Les élèves du secondaire se sont également joints à la mobilisation, bloquant les cours dans de nombreux cas avec le soutien des enseignants et des parents.
Nous avions déjà évoqué sur Meridiano ce qui se passe dans ce pays des Balkans.
À partir des universités bloquées, les étudiants ont formulé quatre revendications à l’adresse des institutions, qui restent aujourd’hui encore sans réponse. Ils demandent que tous les documents relatifs à la reconstruction de la gare de Novi Sad soient rendus publics. Ils exigent l’abandon des poursuites contre les personnes arrêtées et détenues lors des manifestations, ainsi que la poursuite pénale de ceux qui ont agressé physiquement des étudiants et des professeurs lors des manifestations. Enfin, ils réclament une augmentation de 20 % des fonds alloués aux universités publiques.
Les universités bloquées deviennent des lieux où s’organisent des manifestations, des réunions, où se construit et se pratique la solidarité. L’organisation interne des universités occupées devient l’occasion d’expérimenter la démocratie directe à travers les plenums. Il s’agit d’assemblées générales d’étudiants, dans lesquelles chaque étudiant dispose d’une voix, qui font office d’organes décisionnels.
Chaque faculté a son propre plénum, où sont discutées les stratégies de mobilisation et toutes les questions cruciales qui émergent au fur et à mesure de la mobilisation. Les aspects plus spécifiques sont abordés dans des groupes de travail qui s’occupent de questions telles que la reproduction matérielle des occupations (nourriture, dons, matériel pour les manifestations), la communication avec les médias ou la coordination entre les facultés. La participation est réservée aux étudiants et étudiantes de la faculté.
Cette mesure est essentielle pour défendre l’autonomie décisionnelle du mouvement contre les pressions extérieures et les tentatives de répression. En effet, aucune information ne filtre des longues discussions de l’assemblée plénière, et toute décision concernant la mobilisation doit passer par là, sinon elle n’est pas considérée comme valable ou représentative du mouvement. Il s’agit d’une méthode qui caractérise profondément le mouvement, dans lequel la pratique de la démocratie directe et l’absence de leaders ont garanti sa durée et son intégrité jusqu’à aujourd’hui.
Les étudiants mènent le mouvement, toute la société participe
Bien que les étudiants et étudiantes constituent la force motrice des mobilisations, les qualifier d’étudiantes réduit leur portée et leur ampleur. En effet, divers secteurs de la société se sont joints aux protestations dès le début. Le 24 janvier 2025, une grève générale a été proclamée, à laquelle ont participé différents segments du monde du travail : les travailleurs de la culture et de l’éducation, les petites entreprises, le secteur des services et de la technologie, la santé, la justice, l’agriculture. Au cours des mois suivants, d’autres grèves se sont succédé.
Mais la participation populaire s’est surtout répandue lors des manifestations de rue et des longs blocages routiers à Belgrade, Novi Sad et Niš. Chacun y a joué son rôle : les motards et les tracteurs ont assuré la protection des manifestations avec leurs véhicules, les citoyens ont apporté de la nourriture et organisé de véritables cantines dans la rue. Les manifestations ont traversé non seulement les grands centres urbains, mais aussi les petites villes, s’étendant, selon les estimations, à 400 villes et villages.
Le 22 décembre 2024, la première manifestation de masse a vu, à Belgrade, la place Slavia envahie par une foule de plus de 100 000 personnes. Elle a alors été célébrée comme la plus grande manifestation de l’histoire récente de la Serbie, mais quelques mois plus tard, ce record allait être largement dépassé.
Le 15 mars 2025, en effet, un million de personnes ont envahi les rues de Belgrade. Tout cela s’est produit malgré le climat de tension alimenté par le gouvernement et les médias pro-régime qui, dans les jours précédents, avaient tenté de dissuader la population de participer. Alors que le président Vučić prévoyait des affrontements et des troubles, un groupe d’étudiants autoproclamés, les « ćaci », a organisé une contre-manifestation aux caractéristiques grotesques.
Se proclamant « étudiants qui veulent étudier » et protégés par des batinaši (casseurs) et la police, ils ont campé dans le Parc des Pionniers. Leur manifestation était une nouvelle tentative du gouvernement de donner l’image d’une société divisée entre opposants et partisans du régime, et de provoquer des tensions et des violences. Malgré cela, une foule immense a envahi pacifiquement Belgrade, jusqu’à ce que les quinze minutes de silence habituelles soient interrompues par un bruit soudain, provoquant une panique générale et la dispersion du cortège.
Au cours des jours suivants, plusieurs témoignages ont affirmé que le bruit provenait d’un canon sonore, le Long Range Acoustic Device (LRAD), qui émet un son de 160 décibels perceptible jusqu’à 5,5 kilomètres de distance, et qui est donc interdit dans le domaine civil. L’utilisation de ce canon provoque des symptômes physiques graves, tels que des douleurs prolongées aux oreilles, des nausées, des difficultés respiratoires, une tachycardie et d’autres symptômes constatés chez les manifestants qui se sont rendus aux urgences dans les jours qui ont suivi.
Malgré de nombreux témoignages, Vučić, le ministre de l’Intérieur et les dirigeants de l’armée et des services secrets ont nié en posséder, puis l’avoir utilisé pendant la manifestation, et aucune enquête n’a été ouverte pour établir les faits.
Une révolution souriante qui reconnecte la Serbie
L’une des clés de la propagation massive des manifestations et de leur durée a certainement été la capacité des étudiants et des étudiantes à trouver des pratiques innovantes et créatives pour répondre aux défis de la mobilisation. Dès février, les étudiants ont commencé à entreprendre des marches de plusieurs kilomètres pour atteindre à chaque fois une nouvelle ville. À pied, en courant ou à vélo, ils partaient pour rejoindre une manifestation et inviter les gens à participer à la suivante. Grâce à cette pratique, ils ont contourné les tentatives du gouvernement de bloquer les transports et d’empêcher la participation aux manifestations.
Mais ils ont également démontré leur persévérance, leur force de volonté et la supériorité éthique de ceux qui se mobilisent pour un objectif commun, dont les seules armes sont la solidarité et l’entraide. Tout au long de leur chemin, les habitants les attendaient au bord de la route avec de la nourriture et de l’eau, des embrassades, des sourires et des larmes d’émotion. Des fonctionnaires, des restaurateurs, des commerçants, des citoyens ordinaires ont ouvert leurs portes pour leur offrir un rafraîchissement, leur permettre de soigner leurs blessures aux pieds et les héberger pour la nuit.
À travers ces marches, les étudiants et étudiantes ont porté leurs revendications de changement dans les zones les plus reculées et marginalisées du pays. Ils ont touché une grande partie de la population des zones rurales, où les conditions sociales sont difficiles et où l’information provient principalement des médias du régime. En marchant, ils ont traversé la Serbie de long en large, reconnectant le tissu social constamment fragmenté par les politiques et les discours gouvernementaux. Pas à pas, ils ont manifesté dans les rues de Novi Sad, Belgrade, Kragujevac, Niš, Novi Pazar, Kraljevo.
Certains portaient la šajkača, le couvre-chef traditionnel et militaire serbe, d’autres le hijab, d’autres encore arboraient des symboles revendiquant le Kosovo ou rappelant le passé socialiste. Cette hétérogénéité, expression de l’ampleur populaire du mouvement serbe, n’est certes pas exempte de contradictions. Elle repose sur un minimum idéologique défini par les quatre revendications simples et rigides des étudiants. Aussi minimaliste soit-il, et considéré par certains comme trop peu politique, ce mouvement démontre toute sa dimension politique et son potentiel transformateur, précisément dans sa capacité à unir la complexité et l’hétérogénéité de la société serbe. Elle remet ainsi en question une conception de l’identité serbe fondée sur des principes ethno-nationalistes et essentialistes.
La participation des étudiants et étudiantes de Novi Pazar, une ville du Sandjak, région du sud-ouest à majorité musulmane, restée en marge de la vie politique serbe depuis la fin de la guerre, en est un exemple frappant. Après avoir bloqué leur université et participé à des manifestations dans tout le pays, les étudiants et étudiantes de Novi Pazar ont organisé en avril une manifestation dans leur ville, démontrant ainsi qu’ils font partie intégrante et active de la Serbie et de son processus de transformation. Un processus de transformation sociale qui a déjà atteint des résultats inimaginables.
En avril, les étudiants et les citoyens ont bloqué et occupé le siège de la chaîne de télévision publique, la RTS. Depuis le début des mobilisations, les étudiants ont accusé les médias de ne pas couvrir les manifestations et de servir d’instrument de propagande du régime. Pendant le blocage, un groupe d’anciens combattants a rejoint le bâtiment pour soutenir la manifestation. L’un d’entre eux, un vétéran invalide de guerre qui a participé avec l’armée serbe au siège de Sarajevo, a pris la parole.
Il a admis que sa génération, qui est partie combattre en Bosnie-Herzégovine dans les années 90, a été déformée par les mensonges et la haine des médias manipulés par le régime, tout comme la RTS. Alors que sa génération a cru et accepté ces mensonges, la génération actuelle d’étudiants et d’étudiantes les démasque et les rejette. Il a déclaré que les étudiants
« sont ceux qui répandent l’amour et éclairent l’avenir. Un avenir que nous souhaitons tous, et il est donc du devoir de nos générations qui ont échoué de se lever et de simplement les suivre ».
Il s’est ensuite adressé aux parents des étudiants de Novi Pazar, présents au siège de la RTS pour remplacer leurs collègues orthodoxes pendant les fêtes de Pâques. Il leur a dit de ne pas s’inquiéter, qu’il ne serait pas fait de mal à leurs enfants, car les vétérans les protégeraient comme s’ils étaient les leurs. Car le récit qui a divisé « nos enfants et vos enfants » s’en est fini, a-t-il déclaré. « Ils sont tous nos enfants » et « ce sont les héros d’aujourd’hui ».
Ce discours a exprimé la transformation la plus importante que le mouvement étudiant a apportée en Serbie : la rupture avec les discours nationalistes et diviseurs de l’après-guerre, et la capacité à donner un nouveau sens au drapeau serbe, désormais porté avec fierté par des milliers de personnes sur des centaines de places.
« Que l’Union européenne apprenne les valeurs européennes des étudiants serbes »
Il convient de noter l’absence de soutien aux mobilisations de la part des institutions de l’Union européenne. Au cours de six mois de mobilisation, mais aussi de répression violente et illégale de la part du gouvernement, la population serbe a été laissée seule et a reçu peu de couverture médiatique de la part des grands médias occidentaux. C’est pourquoi les étudiants ont organisé en avril une « tournée » à vélo jusqu’à Strasbourg, suivie d’un marathon, toujours en cours, à destination de Bruxelles. L’arrivée à Bruxelles coïncidera avec une session du Parlement européen au cours de laquelle sera discuté le rapport sur les progrès de la Serbie dans le processus d’intégration.
En parcourant des milliers de kilomètres en quelques dizaines de jours, traversant d’abord six puis sept États, les étudiants et étudiantes ont pris la responsabilité de faire entendre leur voix au Parlement européen, expliquant la situation réelle en Serbie. Il ne faut toutefois pas s’étonner de l’attitude ambiguë de l’Union européenne. Depuis son arrivée au pouvoir, Vučić a bénéficié du soutien de l’UE, qui a favorisé le développement de ce qui a été qualifié de « stabilitocratie » : un gouvernement soutenu de l’extérieur, en tant que partenaire géopolitique garant de la stabilité régionale, au détriment du respect des droits et de la démocratie dans la politique intérieure.
Ces dernières années, en outre, la course à l’hydroélectricité et aux matières premières critiques telles que le lithium pour la transition verte européenne a donné lieu à une série de projets destructeurs qui se sont heurtés à la résistance des communautés locales. Cette prise de conscience, combinée à la « fatigue de l’élargissement » d’un processus d’intégration qui n’apporte pas d’améliorations, a généré une désillusion et un manque d’attentes à l’égard de l’Union européenne de la part des citoyens serbes.
Peut-être est-il temps, comme le dit une pancarte des étudiants, que l’Union européenne apprenne les valeurs européennes du mouvement étudiant, en se retirant de sa complicité avec Vučić et en choisissant de se ranger du côté de ceux qui, depuis six mois, remplissent les places au nom de la justice, de la démocratie et d’une demande de changement. Bien que les revendications des étudiants n’aient pas encore été satisfaites et que l’avenir de la mobilisation soit incertain, le processus de changement est engagé et il n’y a pas de retour en arrière possible. Au cours de ces six mois, le mouvement étudiant a réussi à reconnecter la société serbe, à pratiquer des formes de solidarité populaire et de démocratie directe, à remettre ouvertement en question trente ans de discours fondé sur la haine nationaliste.
Il a réussi à « éclairer l’avenir », en ravivant l’espoir des nouvelles générations, en Serbie et dans le reste de la région, de pouvoir imaginer un avenir dans leur propre pays plutôt que de le chercher ailleurs. Les défis auxquels le mouvement devra faire face sont encore nombreux, à commencer par la possibilité d’élections anticipées. En attendant, on ne peut que regarder avec gratitude et admiration ces jeunes hommes et femmes qui écrivent un nouveau chapitre de l’histoire serbe.
* Aida Kapetanović est chercheuse en sciences politiques et sociologie pour le programme régional RECAS, coordonné par les universités de Rijeka et de Belgrade, et collabore avec l’organisation Fondacija ACT en Bosnie-Herzégovine. Elle s’intéresse aux luttes écologistes et aux mouvements sociaux dans les Balkans occidentaux, combinant recherche et militantisme. Elle a obtenu son doctorat à l’École normale supérieure de Florence, avec une recherche sur les luttes pour la défense des fleuves en Bosnie-Herzégovine et en Serbie. Née à Mostar, elle a grandi en Italie en tant que réfugiée et est récemment revenue dans son pays d’origine.
Posted in internationale