-
AGENDA
Fév28sam14 h 00 min La 4e internationale et « la rad... @ La contemporaineLa 4e internationale et « la rad... @ La contemporaineFév 28 @ 14 h 00 min – 18 h 00 min Journal du secteur lycéen de la LC et des cercles rouge lycéens, février 1971 samedi 28 à 14 h à La contemporaine. Robi Morder (Germe, chercheur associé au laboratoire printemps (UVSQ Paris Saclay), membre du[...]
Journal du secteur lycéen de la LC et des cercles rouge lycéens, février 1971 samedi 28 à 14 h à La contemporaine. Robi Morder (Germe, chercheur associé au laboratoire printemps (UVSQ Paris Saclay), membre du[...] CHAINE YOUTUBE DE LA CITE
SEMINAIRES
COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE
Catégories
- appel à contributions
- archives et mémoires
- axes de recherche
- cahiers du germe
- collection germe aux éditions Syllepse
- dans d'autres éditions
- dictionnaire biographique et prosopographie
- internationale
- La lettre électronique
- mouvement étudiant et jeunesse
- mouvement étudiant et milieu étudiant
- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société
- mouvements étudiants et institution universitaire
- Non classé
- notes de lecture
- séminaires
- vie du germe
Étudier les mouvements étudiants
lectures. Julie Pagis, Mai 68, un pavé dans leur histoire: Évènements et socialisation politique
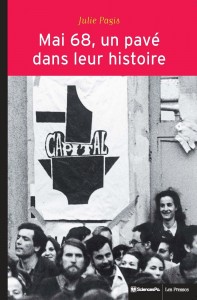 Le « long mai » des soixante-huitards ordinaires (et de leurs enfants). A propos de Julie Pagis, Mai 68, un pavé dans leur histoire. Évènements et socialisation politique, Paris, Presses de Sciences Po, coll.« Sociétés en mouvement », 2014, 307 p., bibliographie, annexes.
Le « long mai » des soixante-huitards ordinaires (et de leurs enfants). A propos de Julie Pagis, Mai 68, un pavé dans leur histoire. Évènements et socialisation politique, Paris, Presses de Sciences Po, coll.« Sociétés en mouvement », 2014, 307 p., bibliographie, annexes.
« Qui sont celles et ceux qui ont fait Mai 68? Pourquoi et comment leur trajectoires individuelles sont-elles alors entrées en résonance avec l’histoire? Le cours de leur existence en a-t-il été dévié? En portent-ils encore aujourd’hui les marques? Leurs enfants en ont-il hérité? » C’est à partir de ce questionnement multiple (p.14), pouvant être résumée dans une problématique mettant en relation l’évènement et la socialisation politique, que Julie Pagis, chercheuse au CNRS et fille d’agriculteurs néo-ruraux[1], mène une enquête d’ampleur auprès de ceux et celles qu’elle qualifie de « soixante-huitards ordinaires » (p.17).
Loin des représentations médiatiques dominantes, faisant état d’une « génération opportuniste, bien reconvertie, occupant des postes de pouvoir dans les champs politique, médiatique et littéraire, et humainement convertie au libéral-libertarisme » (p.17), l’auteure questionne tout d’abord la pertinence du prisme générationnel pour décrire les protagonistes du Mai français : il s’agit pour elle de « déconstruire la catégorie génération soixante-huitarde par la mise en évidence empirique de différentes micro-unités de génération, irréductibles à une interprétation univoque » (p.18). S’en suit un raisonnement articulant le temps long – l’analyse des trajectoires antérieures et postérieures à 1968 – et le « temps court de l’évènement » (p.22). Julie Pagis essaie de montrer, d’une part, que l’investissement dans la mobilisation est extrêmement variable, à l’image du parcours – familial, religieux ou politique – de ses acteurs : Mai 68 peut ainsi recouvrir des rôles aussi différents que « l’entretien de dispositions et de convictions antérieures, […] [le] renforcement [de ces dernières], [la] prise de conscience ou encore [la] conversion [au militantisme] » (p.23). D’autre part, la chercheuse entend mettre en évidence d’éventuels effets propres – et durables – de la participation elle-même à l’évènement : si Michel Dobry avait déjà montré que les conjonctures de « crise politique » sont susceptibles de produire des modifications substantielles des visions du monde sur le court terme[2], Julie Pagis questionne de manière originale les répercussions du mouvement de Mai sur le parcours ultérieur de ses protagonistes (voire des enfants de ces derniers), ce qui donne tout son sens au titre de l’ouvrage (« un pavé dans leur histoire »). Ce double programme de recherche, impliquant de rassembler in fine « les différentes pièces du puzzle pour relier l’« amont », le « pendant » et l’« après » Mai 68 », vise à dessiner un « espace social des micro-unités de génération » et à étudier « les éventuelles transmissions d’une génération à l’autre » (p.24).
C’est précisément à partir de ce dernier objectif que Julie Pagis construit le terrain empirique de son investigation. Comment retrouver des participants « lambda » à l’évènement, au-delà des figures de proue régulièrement remises sur le devant de la scène médiatique? La chercheuse suggère de se tourner vers la « deuxième génération » pour remonter à la première : l’accès aux registres – entre 1972 et 1980 – de deux écoles primaires expérimentales, Vitruve (Paris XXe) et Ange-Guépin (Nantes), semble constituer une entrée particulièrement féconde, car ces institutions sont susceptibles d’accueillir des enfants de soixante-huitards « caractérisés par des stratégies éducatives singulières » (p.26). Si ce choix peut paraître à première vue en contradiction avec la volonté d’étudier les protagonistes « ordinaires » du mouvement de Mai, il est en réalité justifié – et pleinement assumé – par l’auteure : bien qu’alternatives, ces deux écoles n’en demeurent pas moins publiques[3]; elles constituent à la fois une opportunité de terrain et un moyen de rassembler un échantillon cohérent, « ni égo-centré, ni parisiano-centré, ni fondé sur des figures publicisés des évènements » (p.26-27) ; elles permettent enfin de confirmer l’hypothèse selon laquelle la scolarisation des enfants n’est pas sans lien avec une certaine « humeur anti-institutionnelle » des parents, caractérisant le parcours de ces derniers en amont, durant et après Mai. Après avoir eu accès aux registres et avoir retrouvé un certain nombre de familles[4], Julie Pagis entreprend une double démarche, quantitative et qualitative – dont l’ampleur mérite d’être soulignée (analyse de 350 questionnaires, réalisation de 89 entretiens biographiques) – pour construire un propos en 7 chapitres chronologiques.
Dans un premier temps, la chercheuse s’intéresse aux racines de l’engagement en Mai. Si l’ensemble des enquêtés ont tous participé à 1968, « ils n’ont fait l’évènement ni de la même manière, ni pour les mêmes raisons » (p.33) : les explications causales les plus répandues – dévalorisation des diplômes, crise universitaire, « déclassement » – sont ici rejetées par la mise en évidence empirique de quatre grandes « matrices », renvoyant à la socialisation familiale, religieuse, scolaire ainsi qu’aux « incohérences statutaires »[5] des futurs militants. Le mythe d’une « génération soixante-huitarde » monolytique vole en éclat au profit d’une analyse fine de l’extraordinaire diversité des parcours des participants à la lutte : Julie Pagis en conclut qu’il est possible d’établir, au mieux, différentes cohortes en fonction du lien entre « dispositions contestataires » et « évènements déclencheurs » de l’engagement – la guerre d’Algérie pour les individus issus de familles communistes, l’anti-impérialisme[6] pour ceux ayant connu une socialisation religieuse, Mai 68 lui-même pour les « intellectuels de première génération »[7] et les jeunes femmes issues des classes supérieures[8] – tout en suggérant l’hypothèse de l’existence d’une sorte de « matrice supérieure », « l’érosion progressive du consentement dans le cadre des « crises sectorielles d’autorité » touchant, au cours des années 1950-1960, les principales institutions qui assurent le maintien de l’ordre social (famille, école, église, etc.) » (p.73). Les profils étudiés sont en effet, dans leur ensemble, des « outsiders, susceptibles de porter un regard critique sur leurs institutions d’appartenance » (ibid.) : bien souvent « dominés parmi les dominants », ils se retrouvent projetés dans un univers qui ne leur est ni totalement familial, ni totalement étranger. C’est au sein de cette contradiction qui se situe le développement d’une « humeur anti-institutionnelle » – dont la généralisation de l’enseignement supérieur et la dévalorisation des diplômes ne sont que deux symptômes parmi d’autres[9] – se concrétisant dans la révolte de Mai.
Le deuxième chapitre est consacré aux « effets socialisateurs » de l’évènement lui-même. Comment le temps court de la crise contribue à façonner « ses » protagonistes? Prolongeant la réflexion entamée dans la partie précédente, Julie Pagis montre, d’un côté, qu’il n’existe pas un seul mais une pluralité de « Mai »[10], ce qui détermine une hétérogénéité de participation et de représentations de 1968[11]. De l’autre, elle analyse les principales manières dont l’évènement – ou, plus précisément, le vécu des évènements – agit sur ceux qui le(s) font. Quatre registres sont mis en évidence, en fonction des ressources accumulées et de l’intensité de la participation : Mai 68 peut représenter une occasion pour les acteurs les plus doués en capitaux militants soit de renforcer leur engagement (« socialisation de renforcement », concernant les enquêtés les plus actifs en 1968), soit de confirmer le bien fondé de leurs convictions antérieures (« socialisation d’entretien » pour les moins exposés à l’évènement). De la même manière, le mouvement offre la possibilité à ceux qui s’engagent pour la première fois[12] soit de « se convertir » à la politique (« socialisation de conversion », touchant ceux qui participent le plus en Mai), soit de « découvrir » l’existence d’une alternative (« socialisation de prise de conscience » en ce qui concerne les moins impliqués). Cette « typologie des formes de politisation induites par Mai 68 » (p.88) ne saurait toutefois masquer l’existence de deux autres facteurs communs à l’ensemble des acteurs, la « dérégulation de l’économie émotionnelle » (p.108) et les « rencontres improbables » avec des « figures charismatiques » (p.111), susceptibles d’infléchir leurs trajectoires – militantes – de manière plus ou moins durable.
Les déplacements du temps court de la crise au « temps biographique »[13] des enquêtés constituent précisément le cœur du chapitre successif, dans lequel la chercheuse questionne les « empreintes sur le long terme de Mai 68 » (p.115). Poursuivant son œuvre de déconstruction de l’existence d’une seule « génération soixante-huitarde », Julie Pagis entame la transition entre l’évènement et le devenir de ses « ex » : si la démarche elle-même n’est pas originale – plusieurs travaux américains des années 1970-1980 montrant que les anciens étudiants contestataires ont plus de chances de se déclarer « radicaux » par rapport aux non-engagés, que ce soit dans le domaine des opinions, du vote ou encore du militantisme[14] – la manière dont elle est adaptée ici ainsi que ses résultats le sont davantage. L’analyse quantitative ne semble en effet fournir que quelques pistes partielles de compréhension de « comment » Mai 68 affecte durablement les sphères professionnelle, affective et militante de la vie des enquêtés. Certes, les statistiques montrent, par exemple, que les participants partagent majoritairement, sur le plan politique, des idées actuellement plus orientées à gauche, anti-libérales ou vouées à l’acceptation des différences culturelles (p.128-129) ; toutefois, s’arrêter à ce constat équivaudrait à gommer les différences intragénérationnelles et à admettre un rôle quasi-mécaniciste de l’évènement dans la formation des opinions[15]. La chercheuse suggère, au contraire, de se tourner vers l’analyse qualitative de quelques récits de parcours dans l’après-mai – que ce soit dans les domaines du travail, du couple, de l’éducation des enfants ou de l’engagement – pour démontrer une thèse véritablement novatrice : ce ne serait pas tant « la participation active aux évènements de Mai 68 qui déstabilise des trajectoires, que ses conséquences en termes d’insertion dans des réseaux de sociabilité postérieurs à Mai 68 » (p.134). Le rôle du mouvement pourrait ainsi être comparé à celui d’un « prisme générationnel qui diffracte les trajectoires antérieures – plutôt que de simplement les refléter – et qui produit plusieurs unités de générations aux empreintes spécifiques » (ibid.), dont rendent compte les deux chapitres qui suivent.
Le quatrième est consacré aux « inflexions biographiques » et aux « rénégociations identitaires » dans la sphère professionnelle des enquêtés : Julie Pagis montre que bon nombre de « soixante-huitards [ordinaires] travaillent – dans l’après-Mai – à ne pas reproduire l’ordre social » (p.135), que ce soit en allant « s’établir » à l’usine[16] (ou, au contraire, en empruntant des passerelles du monde du travail à celui de l’Université[17]), en transformant leur engagement en faveur de l’éducation populaire en véritable profession ou encore en reconvertissant des ressources militantes dans la recherche en sciences sociales[18]. Une fois de plus, la chercheuse rejette empiriquement les idées reçues autour de l’unanimité des destins des protagonistes du mouvement de 1968 : les cas de Colette, Paul, Gilles, Francis ou Louis remplacent ici ceux de Serge (July), Daniel (Cohn-Bendit), Alain (Finkielkraut), André (Glucksmann) ou Regis (Debray), afin de signifier au lecteur que « l’engagement produit tantôt du déclassement […] tantôt de la promotion sociale. Inversement, il peut résulter de l’ascension sociale […] ou être investi comme un moyen de compenser la mobilité sociale descendante » (p.178).
L’hétérogénéité des parcours (post-)soixante-huitards est également mise en évidence dans un autre domaine, la sphère privée : « dès le début des années 1970 – écrit l’auteure – nombre d’enquêtés cherchent […] à perpétrer leur militantisme en s’attaquant aux logiques familiales et sociales de la reproduction sociale. La participation à Mai 68 se trouve ici à l’origine d’une rédéfinition critique des rapports sociaux de sexe, de génération et des métiers de parents d’enfants » (p.181). Dans ce cinquième chapitre, Julie Pagis s’intéresse, en particulier, aux destins de celles et ceux pour qui l’évènement a joué un rôle de prise de conscience : ces derniers, dans l’après-Mai, investissent politiquement leur quotidien, que ce soit en militant contre le patriarcat dans les mouvements féministes, en expérimentant des modes de vie communautaire ruraux ou urbains, en refusant l’héritage[19], en donnant une éducation anti-autoritaire à leurs enfants[20], etc. . Ces différentes formes de « marginalité » ne vont pas sans leur lot de ruptures, de bouleversements et de stratégies de reclassement plus ou moins réussies. Si certains signes de cette période sont encore visibles à l’heure actuelle – hexis corporelle anticonformiste[21], trajectoire professionnelle chaotique, isolement, recours à la psychanalyse, etc. – les enquêté(e)s[22] de cette portion de l’échantillon partagent – du moins, à un certain moment de leur vie – un « habitus utopique » forgé par les évènements de Mai : l’ouverture temporaire du champ des possibles en 1968 produit des « aspirations nouvelles sans assurer, dans la plupart des cas, les moyens de les satisfaire. Cette dissonance entre aspirations et possibilités de les satisfaire se trouve à l’origine de représentations utopiques du monde social »[23] (p.216), dont les fuites individuelles (dans la drogue, sur la route, dans la dépression), l’humeur anti-institutionnelle et les communautés[24] représentent autant de conséquences visibles (et, selon les cas, relativement durables). La double imbrication du tempo de la crise dans la biographie des participants – d’une part – et de la cohorte dans l’ensemble des soixante-huitards interrogés – de l’autre – anticipe les résultats du chapitre qui suit, dans lequel la chercheuse s’attaque à rassembler les différentes pièces de son « puzzle » pour dégager un « espace social des micro-unités de génération 68 ».
Synthétisant les résultats de son enquête, l’auteure isole une quinzaine de groupes de profils de participants ordinaires à l’évènement : les deux premiers sont établis en fonction du genre des protagonistes, car les femmes semblent avoir été davantage marquées par la mobilisation de 1968 que les hommes[25]. Les micro-unités restantes sont dégagées en combinant plusieurs autres critères[26], dont l’âge et les schèmes de politisation sont les principaux[27]. Ce qui frappe, une nouvelle fois, c’est l’extraordinaire diversité des protagonistes du mouvement de Mai (et de leurs devenirs) : à titre d’exemple, les enfants de juifs communistes politisés pendant la guerre d’Algérie, les « établis » maoïstes issus de familles croyantes, les ouvriers non-bacheliers qui s’inscrivent à Vincennes et les étudiantes bourgeoises qui expérimentent le « retour à la terre »[28] ne partagent entre eux – au mieux – que quelques caractéristiques formelles[29], sans pour autant avoir fait le même évènement, pour les mêmes raison et sans en avoir été affectés de la même manière. Julie Pagis observe, néanmoins, que la participation à – ou, mieux, « aux » – 68 produit l’infléchissement de la trajectoire d’une majorité d’enquêtés : loin de représenter une contradiction vis-à-vis des résultats exposés précédemment, cette remarque les nuances de manière constructive, car, selon la chercheuse, Mai 68 ouvre la voie à « de nouvelles fréquentations politiques, professionnelles, amicales ou amoureuses » (p.252). Autrement dit, le temps court de l’évènement se répercute – avant tout – sur le temps biographique des participants par l’insertion dans de nouveaux réseaux de sociabilité, susceptibles de déstabiliser leur parcours ultérieur : si le caractère novateur de cette thèse a déjà été souligné, sa portée semble encore plus grande lorsque sont analysées les conséquences du mouvement sur les trajectoires des enfants des enquêtés.
Dans le septième et dernier chapitre, l’auteure interroge les ricochets intérgénérationnels de Mai 68 : « un évènement politique peut-il avoir, et sous quelles conditions, des répercussions sur la génération suivante, qui n’y a pas été exposée directement ? » Pour tenter de répondre à cette question (p.255), Julie Pagis mobilise les outils qui lui ont servi tout au long de son enquête, notamment les entretiens et les questionnaires fournis par les enfants scolarisés à Vitruve et à Ange-Guépin. La chercheuse montre, d’une part, que la mémoire des évènements et les préférences politiques semblent se transmettre assez bien au sein des familles soixante-huitardes, même si la « deuxième génération » apparaît nettement moins militante que la première. De l’autre, elle s’attaque à dessiner « un espace social [du devenir] des enfants des soixante-huitards » (p.271). Cette tâche est ardue à plus d’un titre : porteurs de dispositions contradictoires, la plupart de ces enfants, jadis élèves dans des écoles primaires expérimentales, se retrouvent rapidement propulsés dans des collèges, lycées (voire des universités) « traditionnels » avant d’intégrer – ou de réfuter – un monde du travail en évolution par rapport à celui de leur parents. Ce conflit « entre une socialisation primaire contre-culturelle et la socialisation secondaire […] [qu’ils connaissent] dès l’intégration du système scolaire classique » produit ce que l’auteure qualifie de « dyssocialisation »[30] (p.262) : la confrontation avec des pairs éduqués, voire habillés de manière plus « normale », possédant une télévision, ne manifestant pas depuis leur plus jeune âge, etc. façonne, sur un terme plus ou moins long, tantôt le rejet des stratégies éducatives singulières qu’ils ont connues, tantôt leur approbation, tantôt un regard critique. Si l’on ajoute à ces facteurs des éléments d’ordre conjoncturel – la précarisation du marché du travail, l’étiolement de la conflictualité sociale, etc. – propres aux années 1980-1990, il semble très difficile de pouvoir dégager des micro-unités de génération des « héritiers » de 1968 aux contours aussi nets que celles de leurs parents. Julie Pagis y parvient néanmoins en élaborant une typologie en fonction de deux facteurs principaux : le regard rétrospectif porté sur la (dys)socialisation vécue par les enfants et le rapport que ces derniers entretiennent actuellement avec la politique. Il en résulte, comme pour les protagonistes du Mai, une grande diversité de profils, allant des « héritiers du quotidien » à ceux qui réfutent l’héritage de 68, en passant par des enquêtés devenus aujourd’hui militants à l’extrême gauche ou qui se réclament de manière ambivalente de leur enfance contre-culturelle. Cette esquisse, mettant un terme à l’enquête, permet de comprendre une fois de plus comment un évènement d’envergure, voyant la participation de protagonistes aussi hétérogènes que les soixante-huitards, ne peut « faire ricochet » sur la génération suivante qu’en produisant des micro-unités aux empreintes spécifiques. Elle corrobore par ailleurs les hypothèses les plus connues sur la transmission familiale des préférences politiques, tout en introduisant une double spécificité – conjoncturelle et (dys)socialisatrice – qui ouvre la voie au développement de recherches ultérieures sur les enfants des participants au mouvement de Mai. Cependant, il est quelque peu regrettable qu’elle se cantonne à un seul chapitre de l’ouvrage, eu égard du rôle spécifique joué par les écoles expérimentales en matière d’« entrée sur le terrain »[31] et de la vocation intergénérationnelle de l’enquête, exposée dès ses premières pages.
En conclusion, Mai 68, un pavé dans leur histoire constitue un apport indéniable à la recherche en « sciences historiques »[32], quelle qu’elle soit la branche prise en considération. D’un point de vue proprement historiographique, l’enquête permet de porter un regard sérieux, différent et différencié sur des cohortes réduites, la plupart du temps, à une seule et même unité générationnelle, tout en contribuant à l’écriture d’une histoire sociale des « années 68 » en général, de la mobilisation de Mai en particulier. D’un point de vue plus sociologique, l’ouvrage aborde une multitude de questions – les générations, les conséquences biographiques de l’engagement, les rapports entre les évènements et la (re)socialisation politique, etc. – de manière novatrice, en proposant à chaque fois des pistes solidement étayées par l’obtention de résultats qualitatifs ou quantitatifs. Du point de vue qui intéresse le plus les lecteurs des cahiers du GERME, enfin, l’enquête participe à l’analyse des mobilisations étudiantes en France à deux titres principaux : si, d’un côté, elle remet en question les principales explications causales de Mai 68, elle invite, de l’autre, à saisir toute la diversité des motivations – et des profils – des participants à la lutte. Elle ouvre ainsi un vaste champ de recherche sur ces milliers d’anonymes qui ont croisé, d’une manière ou de l’autre, la question universitaire dans les années 1960-1970, au delà des figures de proue bien connues dans le champ médiatique et, avouons-le, trop souvent mises en avant par le champ scientifique.
[1]Comme le précise l’auteure elle-même dans l’introduction, l’enquête a des origines autobiographiques : Julie Pagis est en effet fille de soixante-huitards aux origines bourgeoises et cultivées, ayant vécu un temps en communauté, installés depuis 1974 dans la Drôme en tant qu’éleveurs. [2]Voir Michel DOBRY, Sociologie des crises politiques. Les Dynamiques des mobilisations multisectorielles, Paris, Presses de Sciences Po, 1986. [3]Excluant, de facto, les « utopies éducatives parallèles », caractérisant une fraction réduite de participants aux évènements (« écoles sauvages », éducation à la maison, etc.). Pour un panorama de ces différentes expériences, voir Luc BERNARD, Les écoles sauvages, Paris, Stock 2, coll.« Vivre », 1977. [4]Après avoir passé plus de 2 ans à rechercher leur traces dans l’annuaire, avoir envoyé plus de 660 questionnaires par la poste et avoir essuyé un certain nombre de refus. [5]Matrice spécifique aux étudiants, concernant notamment les jeunes femmes les moins dotées en capital militant qui se politisent avec (et dans) les évènements de Mai. [6]En particulier, les luttes contre la guerre du Vietnam et celles en faveur des mouvements de libération en Amérique Latine, caractérisant des reconversions – improbables – entre la sphère religieuse et la sphère politique (par exemple, de jeunes catholiques d’origine bourgeoise en militants maoïstes). [7]C’est-à-dire les individus bénéficiant pour la première fois dans leur famille de l’enseignement secondaire. [8]Correspondant à la quatrième matrice décrite supra. [9]Et, en aucun cas, pas les seules causes, loin d’une vision mécaniciste de l’évènement-68. [10]Apportant une réponse empirique à la suggestion d’analyser l’existence de plusieurs « Mai », formulée par Bernard Lacroix dans la préface d’ouvrage relativement ancien : « un Mai 68 universitaire et un mai 68 social, […] un ou des Mai 68 ouvriers, un ou des Mai 68 paysans, un ou des Mai 68 syndicaux, des Mai 68 provinciaux ». Voir Bernard LACROIX, L’utopie communautaire. Histoire sociale d’une révolte, Paris, Presses Universitaires de France, 2006, (1981). [11]Au sens de visions de l’évènement déployées par les participants : par exemple, le sentiment de « vivre un moment d’histoire », de « faire la révolution, mais sans trop y croire », etc. (p.77). [12]En réalité, cette répartition introduit une troisième variable, l’âge, car ces deux derniers ensembles d’enquêtés sont sensiblement plus jeunes que ceux décrits dans les deux catégories précédentes. [13]Entendu, ici, comme le long terme, en adaptant librement une notion élaborée par Olivier Fillieule. Voir Olivier FILLIEULE, « Temps biographique, temps social et variabilité des rétributions » in Olivier FILLIEULE (dir.), Le désengagement militant, Paris, Belin, coll. « Sociologiquement », 2005. [14]Voir par exemple Doug Mc ADAM, Freedom Summer, New York, Oxford University Press, 2006, (1988). [15]Le même discours pourrait être fait pour les sphères professionnelle et affective. [16]L’« établissement » désigne, dans les années 1968, une pratique touchant les étudiants d’extrême-gauche (en général maoïstes) qui abandonnent les bancs des universités pour se faire embaucher en usine. [17]Le cas des « établis » et celui des « ouvriers à l’Université » (en particulier à Vincennes, ouverte aux non bacheliers) témoignent, de manière complémentaire, d’un décloisonnement social entre le monde étudiant et celui du travail dans l’après-68. [18]Autrement dit, « la reconversion d’intérêts militants pour la politique en intérêts savants pour le politique » (p.175). L’auteure présente ici les parcours d’une quinzaine de spécialistes reconnus en sciences sociales épousant la cause de la « sociologie critique » bourdieusienne dans l’après-68 : « en faisant de la rupture avec le sens commun leur métier, ces jeunes chercheurs ont réussi à négocier la douloureuse sortie d’identités révolutionnaires sans renier leurs dispositions à la critique sociale. Ce faisant, ils ont participé à la rédéfinition d’objets, de méthodes, voire de sous-champs disciplinaires des sciences sociales » (p.178). [19]Au sens matériel du terme. [20]Comme l’écrit l’auteure, « l’enfance est en effet investie par la sous-population qui nous intéresse comme un champ d’expérimentation politique » (p.193). [21]Sur ce point, voir également Julie PAGIS, Conditions sociales de l’accord dans un contexte d’action collective. Attac et la Confédération Paysanne. Enquête ethnographique sur deux configurations locales, Paris, ENS-EHESS, mémoire de DEA, 2003. [22]Les femmes étant plus touchés que les hommes par ces phénomènes. [23]Cette hypothèse, par admission de l’auteure, rejoint celle développée par Bernard Lacroix dans l’ouvrage L’Utopie Communautaire (op.cit.), à la différence près qu’elle est moins mécaniciste, ne ramenant pas systématiquement la dissonance entre les aspirations et leur satisfaction au déclassement des acteurs. [24]Nous pourrions néanmoins objecter un trop grand lien entre ces expériences et la mobilisation de Mai, comme le montrent un certain nombre de contre-exemples communautaires antérieurs à 1968. Voir Paolo STUPPIA, De la communauté à l’éco-village. L’expérience des néo-ruraux, trente ans après, Université Paris I, mémoire de Master 2, 2008. [25]Ainsi, « quand « ils » déclarent avoir « fait 68 », « elles » déclarent « avoir été faites » par 1968 » (p.226) : les féministes, issues des classes moyennes de gauche, politisées avec la guerre du Viet-Nam et les enquêtées aujourd’hui seules, déclassées, dépressives constituent les deux premières micro-unités de génération (p.235). [26]L’âge, le sexe, les schèmes de politisation, la trajectoire militante antérieure et postérieure à 1968, le registre de participation aux évènements, le statut occupé en Mai, l’incidence de la mobilisation sur la sphère professionnelle et privée, le comportement électoral en 2002. [27]Constituant, ainsi, trois sous-ensembles distincts : le premier, formé par les enquêtés les plus âgés, politisés avec la guerre d’Algérie, regroupe quatre cohortes (intellectuels de première génération issus des familles catholiques de droite, enfants de juifs communistes en ascension sociale, ouvriers non-bacheliers syndicalistes en 68, étudiants d’origine aisée contestant les rapports éducatifs). Le deuxième, intermédiaire en terme d’âge, concerne les soixante-huitards politisés dans les luttes tiers-mondistes. Trois micro-unités sont mises en évidence : les étudiants issus des familles catholiques de droite, les étudiants bourgeois qui deviennent permanents politiques après Mai, les enseignants d’origine populaire qui n’ont jamais cessé de militer. Le troisième sous-ensemble, enfin, est constitué par les enquêtés les plus jeunes, politisés dans l’évènement lui-même. Trois cohortes sont isolées par l’auteure : les enquêtées féministes, d’origine moyenne-supérieure ayant connu un mode de vie communautaire, les trotskistes reconvertissant leurs ressources militantes dans la contre-culture et, enfin, les intellectuels de première génération qui militent par leur profession. [28]Les « néo-ruraux » évoqués supra. [29]La date de naissance – aux nuances près évoquées précédemment – et le fait de prendre partie à une conjoncture spatio-temporelle particulière, Mai 68 en France. [30]En adaptant librement une notion élaborée par Louis Chauvel. Voir Louis CHAUVEL, Le Destin des générations. Structure sociale et cohortes en France au XXe siècle, Paris, PUF, 2002. [31]L’auteure précise néanmoins que des indications plus complètes peuvent être retrouvées dans le chapitre préliminaire de sa thèse, dont le présent ouvrage est une adaptation. Voir Julie PAGIS, Les incidences biographiques du militantisme en Mai 68. Une enquête sur deux générations familiales : des « soixante-huitards » et leurs enfants scolarisés dans deux écoles expérimentales, Paris, ENS-EHESS, Thèse de Doctorat, 2009. [32]C’est-à-dire l’ensemble des disciplines enquêtant « sur des « faits » qu’on peut observer dans le monde historique », se distinguant de la position des sciences de la nature. Voir Jean Claude PASSERON, Le raisonnement sociologique. Un espace non-poppérien de l’argumentation, Paris, Albin Michel, 2è éd., 2006, (1991).



