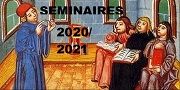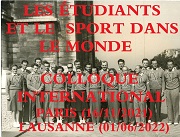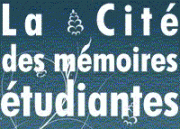-
AGENDA
Fév28sam14 h 00 min La 4e internationale et « la rad... @ La contemporaineLa 4e internationale et « la rad... @ La contemporaineFév 28 @ 14 h 00 min – 18 h 00 min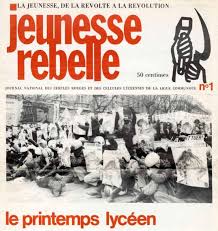 Journal du secteur lycéen de la LC et des cercles rouge lycéens, février 1971 samedi 28 à 14 h à La contemporaine. Robi Morder (Germe, chercheur associé au laboratoire printemps (UVSQ Paris Saclay), membre du[...]
Journal du secteur lycéen de la LC et des cercles rouge lycéens, février 1971 samedi 28 à 14 h à La contemporaine. Robi Morder (Germe, chercheur associé au laboratoire printemps (UVSQ Paris Saclay), membre du[...] CHAINE YOUTUBE DE LA CITE
SEMINAIRES
COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE
Catégories
- appel à contributions
- archives et mémoires
- axes de recherche
- cahiers du germe
- collection germe aux éditions Syllepse
- dans d'autres éditions
- dictionnaire biographique et prosopographie
- internationale
- La lettre électronique
- mouvement étudiant et jeunesse
- mouvement étudiant et milieu étudiant
- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société
- mouvements étudiants et institution universitaire
- Non classé
- notes de lecture
- séminaires
- vie du germe
Étudier les mouvements étudiants
Mobilisations étudiantes, entre démocratie directe et blocus : nouvelles formes de lutte dans la Serbie des années 2000
Le mouvement étudiant actuel en Serbie[*], qui s’élargit au reste de la société serbe, et dont nous avons fait état sur notre site, a des précédents. Dans quelle mesure et par quels vecteurs l’expérience et les mémoires des luttes anciennes se transmettent, si elles se transmettent? C’est une question qui mérite des recherches, et sur laquelle nous reviendrons. Toutefois il est déjà utile de rappeler les luttes des années 2000. Les deux chercheuses Jovana Papovic et Astrea Pejovic avaient communiqué à notre colloque de 2015 la contribution que nous avons publiée dans Démocratie et citoyenneté étudiantes depuis 1968 aux éditions Syllepse en 2020.
La présente communication aborde la question de l’émergence de nouvelles formes de luttes étudiantes dans la Serbie des années 2000. Abandonnant peu à peu la manifestation comme pratique collective et la rue comme espace de protestation, les méthodes de lutte des étudiants se radicalisent et se concentrent dans l’enceinte de la faculté bloquée. Nous nous efforcerons de décrire dans un premier temps les conditions de mise en place de ces luttes contemporaines et de spéculer dans un second temps sur leur efficience. Pour comprendre ce changement de paradigme, il semble nécessaire avant tout de revenir succinctement sur l’histoire du militantisme étudiant en Serbie.
Les étudiants serbes ont joué un rôle majeur dans les grands tournants politiques et sociaux qui ont traversé le pays pendant le siècle passé. Les débuts du militantisme étudiant datent de l’entre-deux-guerres, quand les étudiants belgradois s’engagent massivement dans le Mouvement révolutionnaire étudiant (Studentski Revolucionaksi Pokret) et quand, dès le début de la Seconde Guerre mondiale, ils viennent grossir les rangs de la lutte antifasciste, en se joignant aux unités de l’Armée populaire de libération (les partisans). Plus tard, en mai 1968, les étudiants de l’université de Belgrade se joignent à la vague de mécontentement qui traverse la plupart des pays occidentaux. Cette année-là, les étudiants belgradois se soulèvent massivement contre la corruption au sein de la Ligue des communistes de Yougoslavie et demandent un socialisme plus égalitaire[1]. La troisième période notable de l’histoire du militantisme étudiant est sans nul doute la décennie 1990, à l’ère du régime de Miloševic et des guerres de Yougoslavie. À cette période, les étudiants sont les premiers à sortir dans les rues pour s’opposer à la guerre. En 1996-1997, ils organisent une des plus longues manifestations anti- régime et motivent la société civile à amorcer la révolution démo- cratique. Les problèmes de l’Université étant alors perçus comme une conséquence directe de la corruption au sein des institutions étatiques, au-delà de leurs revendications antimilitaristes, les étudiants se battent aussi pour l’autonomie menacée de l’Université. Les manifestations de 1996-1997, qui se démarquent par leur durée et leur ampleur, sont organisées à la suite de l’annulation, le 17 novembre 1996, des élections locales par le gouvernement Miloševic. Cette annulation faisait suite à une victoire des forces d’opposition dans la plupart des grandes villes du pays. Suivies par une majorité de citoyens, les manifestations attirent plus de 50 000 étudiants[2]. L’engagement des étudiants a été un élément clé dans l’amorce de la démocratisation du pays. Unis sous la bannière de l’ONG Otpor (résistance), les étudiants sont en première ligne dans la « révolution des bulldozers », le 5 octobre 2000, et s’imposent comme les acteurs privilégiés de la chute du régime de Slobodan Miloševic.
Dans tous ces exemples de révolte étudiante de grande ampleur, le terrain de lutte était presque exclusivement la rue, et dans tous les cas, les revendications étaient principalement communiquées via les canaux habituels de la manifestation : la pétition, le boycott, la grève ou encore l’activisme en ligne.
Les mouvements étudiants confrontés au processus de démocratisation
Durant les premières années de la décennie 2000, les questions idéologiques semblent résolues et le focus politique se déplace vers les questions sociales et les réformes institutionnelles. Le système éducatif n’est pas une priorité et les étudiants semblent accepter que la démocratisation soit un processus lent et complexe. Indépendamment du changement de régime, les problèmes structurels de l’Université restent inchangés. Le nouvel agenda politique ne s’attaque à la question de l’enseignement supérieur qu’en 2005, quand la Serbie met en place la réforme LMD (licence-master-doctorat), via le processus de Bologne, pour s’aligner sur le système éducatif des pays de l’Union européenne. La nouvelle loi relative à l’enseignement supérieur est adoptée en 2005 et l’on peut considérer qu’elle représente le prélude au réveil des étudiants.
Le processus de Bologne a introduit des changements fondamentaux dans l’enseignement supérieur serbe. Les cycles d’études sont réorga- nisés et divisés en trois étapes : licence, master et doctorat. La réforme impose aussi la création d’un parlement étudiant, organe officiel dont le but est de faire participer les étudiants à la prise de décision (autour de questions qui touchent à l’Université et l’enseignement supérieur). Grâce à cette nouvelle loi, le militantisme et l’action étudiante sont censés gagner un caractère institutionnel. La réforme est suivie par la création de diverses autres organisations, syndicats et autres initiatives, au statut indéterminé dans le cadre de la législation de l’Université. Contrairement à toute recommandation de l’UE, l’application de la réforme a eu pour conséquence une réduction notable des finance- ments publics de l’enseignement supérieur, ce qui incite les universités à trouver des moyens alternatifs pour financer leurs programmes. Avant 2005, l’enseignement supérieur était gratuit en Serbie pour une majo- rité d’étudiants (deux tiers des étudiants, classés en fonction de leurs résultats, étaient exonérés de frais de scolarité). Après la réforme, ils ne sont plus qu’un tiers à pouvoir bénéficier de l’exonération. Le coût des études est au-dessus de la moyenne des pays de l’UE (en moyenne 1 500 euros par an). Le processus de Bologne s’impose donc facilement comme nouveau paradigme et il est identifié par les étudiants comme étant une des manifestations concrètes des réformes européennes ayant une incidence directe sur leur vie quotidienne. Le système éducatif devient polygone de reproduction des inégalités[3].
Les conséquences de la réforme incitent les étudiants à se révolter pour la première fois depuis la révolution démocratique. Les revendications accusent le processus de Bologne de n’être qu’une couverture administrative qui vise à instaurer la commercialisation et la privatisation de l’enseignement supérieur. Les étudiants protestataires avancent qu’une logique néolibérale se cache derrière la réforme et affirment que la nouvelle politique de l’enseignement conduit à un système éducatif inégalitaire qui favorise les citoyens les plus aisés[4].
Pour combattre ces changements, les étudiants organisent en 2006 puis en 2007 et 2008 des manifestations dans les rues de Belgrade avec pour slogans « Jetez Bologne aux toilettes » (« Bolonju u klonju ») et « Le savoir n’est pas une marchandise » (« Znanje nije roba »)[5]. Les manifestations rassemblent un nombre conséquent d’étudiants mais n’arrivent pas à créer le consensus à cause du manque de clarté dans la formulation des revendications.[6] Le parlement étudiant, censé accompagner des étu- diants dans leur combat, refuse de suivre le mouvement. Il est important de mettre en avant que le parlement est financé dans sa totalité par les frais de scolarité (2 % de la somme récoltée est versée au parlement pour l’organisation de ses activités et pour la rémunération de ses membres). Cette dépendance place l’organe en situation de conflit d’intérêts et la situation met en lumière un paradoxe : l’organe créé pour protéger les droits et les intérêts des étudiants en est réduit à se battre pour assurer sa propre survie[7].
Le manque de soutien officiel a engendré une radicalisation de la révolte récupérée par des groupes gauchistes et anarchistes. Les struc- tures officielles et les médias n’hésitent pas à comparer les étudiants engagés dans la révolte à des vandales. Dans un tel contexte, la solidarité de la société civile et des citoyens est corrompue et les étudiants sont abandonnés à leur sort.
Radicalisation, blocus et plénum, mise en espace de la démocratie directe
Les étudiants comprendront vite que le dialogue social est impossible et que la manifestation n’est pas le meilleur moyen de faire entendre leurs revendications. Ils décident alors de bloquer la faculté de philologie de Belgrade. Accusant le parlement étudiant de saboter leur mouvement, les étudiants initiateurs du blocus organisent un organe parallèle qui aura pour rôle principal de négocier avec les autorités universitaires et le ministère de l’éducation. Une guerre de légitimité s’installe entre les deux organes. Le parlement étudiant fini par gagner la bataille grâce à un soutien institutionnel et à de plus gros moyens. Au terme de la révolte, aucune des revendications des étudiants n’a été entendue. Le blocus s’impose alors comme moyen de lutte le plus efficace et il sera mis en place par les étudiants en 2007, 2008, 2009 et finalement en 2011 quand le blocus de la faculté de philosophie de Belgrade durera plus de vingt jours.
Le concept de blocus introduit une toute nouvelle dimension dans la révolte des étudiants serbes. Au lieu d’investir la rue, les étudiants tentent de consolider leur mouvement en l’ancrant dans l’enceinte même de la faculté. Pour contrecarrer le parlement étudiant, les protestataires créent un organe alternatif en charge de la prise de décision et de la gérance du blocus : le plénum. En suivant les principes de la démocratie directe, le plénum n’est pas dirigé par un leader mais il s’organise autour de l’engagement collectif et de décisions prises lors d’assemblées plénières. L’idée de la création d’un plénum a été « importée » de Croatie où les étudiants ont bloqué la faculté de philosophie de Zagreb en 2010. Le mouvement des étudiants croates a réussi à recueillir le soutien d’une grande part de la population. Les expériences tirées de la révolte zagréboise ont été publiées dans un ouvrage construit comme un guide et titré The Occupation Cookbook. Ce « guide du bloqueur » est destiné à des protestataires qui souhaiteraient mettre en place ce type de lutte et de prise de décision[8]. En suivant cette recette à la lettre, les étudiants protestataires belgradois créent un plénum qui invite non seulement les autres étudiants à venir débattre de questions qui touchent à l’ensei- gnement supérieur, mais invite aussi les citoyens dans leur ensemble. L’Université étant considérée comme un bien commun, la société entière est conviée à participer au débat de sa réforme. Les débats organisés lors de ces assemblées plénières tournent autour de l’importance de l’enseignement et de son rôle dans la société, mais ils s’attachent aussi à créer un lien entre la privatisation de l’enseignement supérieur et la privatisation des entreprises publiques, ainsi qu’à questionner le bradage des biens publics dans son ensemble. Le plénum est pensé comme un organe devant interférer entre les étudiants et les autorités universitaires. Les protestataires souhaitant aussi établir leur activité sur toute l’année universitaire et permettre aux étudiants de discuter des questions qui les concernent en dehors du contexte de blocus ou de révoltes. La définition du plénum offerte par The Occupation Cookbook illustre bien le processus et ses objectifs :
Le « plénum » (assemblée plénière, assemblée générale) est un organe central de prise de décision au sein de la faculté occupée. Toutes les décisions sont prises dans le cadre des principes de la démocratie directe, tout comme la décision de continuer ou d’arrêter le blocus. Le « plénum » est une assemblée constituée de tous les étudiants et citoyens intéressés par les questions qui y sont débattues. Tout le monde a le droit de prendre la parole lors du « plénum » et de voter à main levée. Toutes les décisions sont prises par la majorité des participants présents. Toute session plénière est modérée par deux facilitateurs et à chaque fin de session, deux nouvelles personnes sont désignées pour modérer la session suivante. Pendant le blocus, les sessions plénières sont organisées tous les jours et hors période de blocus, elles sont organisées une fois par semaine (ou plus fréquemment si nécessaire)[9].
Cette démocratie plénière s’avérera néanmoins être de courte durée : après plus de 20 jours, un grand nombre d’étudiants demande à reprendre les cours (même si les revendications n’ont pas été entendues) et soutenus par un grand nombre de professeurs, ils arrivent à faire plier les protestataires. Il est important de dire que malgré sa durée et son ampleur, le blocus a très peu été suivi par les médias, qui se sont rapidement désengagés de la cause et n’ont pas hésité à comparer les étudiants à des vandales et à des gauchistes.[10]
À la suite du mouvement, les étudiants protestataires se sont regroupés autour du Front étudiant (Studentski Front), un organisme qui milite pour la gratuité de l’enseignement supérieur[11]. Le mouvement étudiant de 2011 fut le premier véritable blocus mais cette méthode de lutte a été réutilisée, et tous les mouvements étudiants depuis 2011 sont orga- nisés sous forme de blocus et mis en place dans le cadre de plénums qui fonctionnent sous le principe de la démocratie directe. Le dernier blocus en date (octobre-novembre 2014) a duré près de 55 jours, les étudiants protestataires ont été obligés de limiter leurs revendications à un compromis sur l’ajustement des frais de scolarité et ils ont dû aban- donner l’idée de la gratuité de l’enseignement.
Étant donné sa limitation dans l’espace et le temps, cet établissement temporaire d’une forme de démocratie directe peut être interprété comme une sorte de performance, une pratique qui servirait comme « répétition théâtrale » d’un contexte propice à l’identification de cha- cun avec son rôle politique au sein de la société. L’amphithéâtre se transforme ainsi à la fois en scène de théâtre grec (où l’on imite une réalité possible) et en agora grecque (où l’on met cette réalité en débat). Ainsi, la faculté de philosophie de Belgrade où les plénums ont été mis en scène, a servi de terrain de reconstruction d’une société présentée par les étudiants comme égalitaire et solidaire. Cet espace peut être ainsi considéré comme le miroir déformé d’une réalité possible. En ce sens, les participants aux plénums deviennent des acteurs auxquels les citoyens peuvent s’identifier, et l’Université devient la métaphore de la société néolibérale où les biens publics se font dévorer par le capital privé.
Manque d’appui populaire : causes et conséquences
Contrairement aux mouvements étudiant des années 1990 qui ont réussi à engager la société civile dans sa totalité et à réveiller les consciences politiques d’une grande part de la population, les nouvelles formes de lutte étudiantes aux méthodes radicales peinent à sensibiliser et attirer le soutien des citoyens. La population serbe semble ne pas considérer le problème étudiant comme une question d’intérêt général et se désolidarise massivement des questions posées par les étudiants. Nous pouvons ici essayer de spéculer sur les causes du déclin du pou- voir des luttes étudiantes dans une Serbie en transition démocratique.
Alors que les revendications du mouvement de 1996-1997 étaient principalement dirigées contre un adversaire personnifié et individué – Slobodan Miloševic, l’adversaire des étudiants lors des mouvements des années 2000 n’est pas incarné. Le mouvement est dirigé contre les réformes institutionnelles européennes et le processus insaisissable de néolibéralisation de la société serbe. L’ennemi se présente comme flou et difficile à localiser. L’absence d’un ennemi incarné et reconnaissable complique l’engagement de la société civile, de la masse étudiante, mais aussi de la population dans son ensemble. Les objectifs des mouvements et révoltes des années 1990 sont aussi très différents de ceux des mouvements contemporains. En 1996-1997, les étudiants se battaient « pour » l’instauration de la démocratie. Cet objectif positif, promettant un modèle d’avenir concret (du moins en théorie) arrivait facilement à attirer les foules.
Dans les années 2000, les étudiants ne se battent plus « pour », mais
cette fois-ci « contre » un amalgame de processus – le processus de Bologne, la privatisation de l’enseignement supérieur, le néolibéralisme. De plus, ces revendications négatives sont encastrées dans un système démocratique déjà instauré, système que la majorité des citoyens a du mal à remettre en question.
Le changement radical des méthodes de protestation est aussi un autre facteur qui contribue potentiellement au déclin du pouvoir étudiant dans les années 2000. Au lieu d’investir l’espace public où le combat serait rendu visible et perceptible par une majorité, les étudiants choisissent de s’enfermer dans la faculté, limitant ainsi leur champ d’action et incitant la population à ne comprendre leur combat que comme exclusivement interne. Aussi, tandis que les étudiants des années 1990 se servaient de l’élément carnavalesque et de l’humour comme principal outil d’interaction avec les autorités d’une part, mais aussi comme principal outil de communication avec la population de l’autre, arrivant ainsi à toucher le plus grand nombre, le plénum, qui sous-entend une parti- cipation active des citoyens, est une méthode qui engage des membres dotés d’une conscience politique aiguë, mais aussi dotés d’esprit cri- tique. Les plénums remettent en question le système de prise de déci- sion dans le cadre de la démocratie représentative en introduisant l’idée de démocratie directe dans une société encore en apprentissage de la démocratie (participative). Ce nouveau type de lutte met les étudiants dans une situation paradoxale : ils souhaitent s’adresser au plus grand nombre, mais ils finissent par n’être compris que par une minorité.
Jovana Papovic, Astrea Pejovic
[*] Sur le mouvement actuel, voir : Le Courrier des Balkans, « Devant la foule, les étudiants ont présenté leur « édit » de démocratie à Niš»; Contretemps, «Mouvement étudiant en Serbie : « Un État-providence, c’est ce dont notre pays a besoin » »; La grande conversation, « Les étudiants bousculent le pouvoir serbe – mais quelle est la prochaine étape ? »; Entre les lignes entre les mots, « Pour les étudiants serbes, la tristesse se transforme en colère ». Sur les mouvements du début de ce 21e siècle, voir également dans Student engagement in Europe: society, higher education and student governance (Council of Europe Higher Education Series No. 20) (2015), Mila Popovic, « Parliaments or streets? »
[1] La lutte des étudiants serbes lors des événements de 1968 reste remarquable par son ampleur et son rôle dans les changements politiques qui lui ont succédé. La protestation de Belgrade visait essentiellement les inégalités du système et l’absence de véritable participation et démocratie interne, et dénonçait l’abandon de l’effort révolutionnaire par la génération des partisans qui s’était transformée en élite bureaucratique. Un des slogans était « À bas la bourgeoisie rouge ! » Chiara Bonfiglioli, «“Bourgeoises” puis “traîtres à la nation”», Tumultes, n° 32-33, 2009, p. 170-194.
[2] Ces manifestations monstres sont un des meilleurs exemples de l’utilisation de l’humour et du carnavalesque dans la communication de revendications politiques.Voir Stef Jansen «The streets of Beograd : Urban space and protest identities in Serbia », Political Geography, n° 20, 2001, p. 35-55 ; Janjira Sombatpoonsiri, «“Excorporation” and “carnival” in humoristic street actions staged for nonviolent struggle : The 1996-7 student potests and the resistance movement (Otpor), Serbia », Thammasat Review, n° 14, 2010-2011, p. 13-34 ; et Milena Dragicevic Šešic, « Street as a political space :The space of carnivalization », Journal of Sociology, n° 39, 1997.
[3] Implémentation du processus de Bologne en Serbie voir : Isidora Jaric et Martina Vukasovic, « Bolonjska reforma visokog školstva u Srbiji : mapiranje faktora niske efikasnosti studiranja », Filozofija i društvo 20, 200, n°. 2 : 119-151.
[4] Une chronologie complète de l’évolution des manifestations est disponible dans l’ouvrage col- lectif en serbo-croate, Tadej Kurepa (dir.), Borba za znanje : Studentski protest 2006, Belgrade, CAD, 2007.
[5] Des images de ces manifestations sont disponibles en ligne, film amateur tourné lors des manifestations étudiantes de 2006, 2007 et 2008, « Bolonju u Klonju », voir www.youtube.com/ watch?v=LTwJqGK6Llo.
[6] La diminution du coût des études était placée au même niveau que l’augmentation des fonds de ressources des bibliothèques. Pour une liste détaillée des revendications des étudiants en 2006, voir « Protestni odbor studenata i studentkinja Filozofskog fakulteta », dans Tadej Kurepa, Borba za znajie…, op.cit.
[7] Le rôle ambigu du parlement étudiant est bien décrit dans Petar Atanackovic, « Novi socijalni pokreti u Srbiji izme?u apatije i protesta », dans Tomic ?orce et Atanackovic Petar (dir.), Društvo u pokretu : Novi društveni pokreti u Jugoslaviji od 1968. do danas, Novi Sad : Cenzura, 2009, p. 235-247.
[8] Drago Markiša, The Occupation Cookbook or the Model of the Occupation of the Faculty of Humanities and Social Sciences in Zagreb, Londres/New York/Port Watson, Minor Compositions, 2011.
[9] Ibid. p. 19.
[10] Allusion très péjorative en Serbie due au grand discrédit apporté aux idées de gauche par la politique ambiguë (socialiste et nationaliste à la fois) menée par Slobodan Milosevic durant les années 1990.
[11] Les événements étant très peu suivis par les médias et n’ayant pas fait l’objet d’étude universitaire, les documents relatifs à la chronologie et à l’évolution du mouvement sont disponibles dans le cadre des archives recueillies par les étudiants eux-mêmes et les textes produits par les protestataires. Ces documents sont disponibles en ligne sur le site Studentski front http://studentskifront.org.rs/.
Posted in internationale