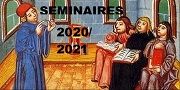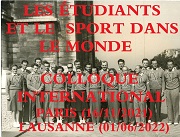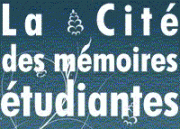-
AGENDA
Nov26mer14 h 30 min L’EGALE DIGNITÉ Chemins croisés... @ Collège de FranceL’EGALE DIGNITÉ Chemins croisés... @ Collège de FranceNov 26 @ 14 h 30 min – 17 h 30 min L’ÉGALE DIGNITÉ Chemins croisés d’une pensée partagée : Mireille Delmas-Marty et Paul Bouchet Paul Bouchet et Mireille Delmas-Marty étaient animés par la même passion du droit. Un droit vivant et non un droit fossilisé, un[...]
L’ÉGALE DIGNITÉ Chemins croisés d’une pensée partagée : Mireille Delmas-Marty et Paul Bouchet Paul Bouchet et Mireille Delmas-Marty étaient animés par la même passion du droit. Un droit vivant et non un droit fossilisé, un[...] CHAINE YOUTUBE DE LA CITE
SEMINAIRES
COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE
Catégories
- appel à contributions
- archives et mémoires
- axes de recherche
- cahiers du germe
- collection germe aux éditions Syllepse
- dans d'autres éditions
- dictionnaire biographique et prosopographie
- internationale
- La lettre électronique
- mouvement étudiant et jeunesse
- mouvement étudiant et milieu étudiant
- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société
- mouvements étudiants et institution universitaire
- Non classé
- notes de lecture
- séminaires
- vie du germe
Étudier les mouvements étudiants
POUR LA RÉFORME DE L’ UNIVERSITÉ (Edmond Ferenczi, 1945)
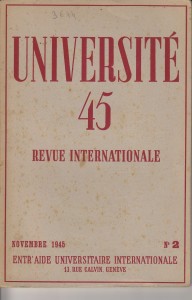 Le texte qui suit a été publiée dans le numéro 2 de Université 45, revue que l’Entraide universitaire internationale (EUI) venait de créer. Cette livraison comportait les contributions communiquées lors d’une rencontre internationale tenue au chalet des étudiants à Combloux du 22 au 29 juillet 1945. Le rédacteur de cet article, Edmond Ferenczi*, est en même temps responsable du département recherche de l’Entraide Cette revue se veut « résolument orientée vers l’avenir, s’efforce de montrer à ses lecteurs les efforts faits dans les différents pays pour renouveler l’enseignement universitaire pour susciter de nouvelles formes de communautés universitaires pour créer des prototypes d’université nouvelle intégré dans la réalité sociale sur le plan national et international ». L’EUI après guerre, s’est voulue non seulement un centre d’entraide immédiat mais également « au service de la réforme universitaire » titre d’un article paru dans le numéro 1 du Bulletin de l’entraide en mars 1946. Le bulletin reparaissait après 6 ans d’interruption. L’entraide universitaire internationale avait dû interrompre la plupart de ses activités entre 1939 et 1945, mais avait crée, avec la Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants (FFACE, protestante) et Pax Romana (catholique), un Fonds européen de secours aux étudiants (FESE) dont nous publions un document de présentation de 1945 (ce lien). C’est le FESE qui avait fait du chalet de Combloux celui des étudiants.
Le texte qui suit a été publiée dans le numéro 2 de Université 45, revue que l’Entraide universitaire internationale (EUI) venait de créer. Cette livraison comportait les contributions communiquées lors d’une rencontre internationale tenue au chalet des étudiants à Combloux du 22 au 29 juillet 1945. Le rédacteur de cet article, Edmond Ferenczi*, est en même temps responsable du département recherche de l’Entraide Cette revue se veut « résolument orientée vers l’avenir, s’efforce de montrer à ses lecteurs les efforts faits dans les différents pays pour renouveler l’enseignement universitaire pour susciter de nouvelles formes de communautés universitaires pour créer des prototypes d’université nouvelle intégré dans la réalité sociale sur le plan national et international ». L’EUI après guerre, s’est voulue non seulement un centre d’entraide immédiat mais également « au service de la réforme universitaire » titre d’un article paru dans le numéro 1 du Bulletin de l’entraide en mars 1946. Le bulletin reparaissait après 6 ans d’interruption. L’entraide universitaire internationale avait dû interrompre la plupart de ses activités entre 1939 et 1945, mais avait crée, avec la Fédération universelle des associations chrétiennes d’étudiants (FFACE, protestante) et Pax Romana (catholique), un Fonds européen de secours aux étudiants (FESE) dont nous publions un document de présentation de 1945 (ce lien). C’est le FESE qui avait fait du chalet de Combloux celui des étudiants.
R.M.
Il peut paraître immodeste, de la part d’un secrétaire de l’Entr’aide universitaire internationale, d’inaugurer un débat qui entendra tant d’universitaires qui ont réellement participé à la guerre contre l’Allemagne et risqué leur santé et leur vie pour des idéaux que nous avons seulement décrits, et grâce aux sacrifices desquels cette réunion libre dans une France libre a été rendue possible. S’il peut être toutefois une justification de prendre la parole pour nous qui n’avons pas participé à l’action, dans le sens guerrier du terme, qui avons passé la guerre derrière une table de travail, c’est que nous avons eu le temps de penser, le temps de formuler un diagnostic, d’essayer de dégager les lois du développement universitaire, de déterminer la cause de la crise de l’Université.
Notre effort de pensée n’a toutefois pas été entièrement abstrait. Par les actions de secours que nos organisations ont menées, nous sommes restés en contact constant et vivant avec la réalité universitaire dans ce qu’elle avait de plus tragique, avec les réfugiés victimes de l’oppression politique, avec les prisonniers perdus dans leurs horizons brumeux, avec les universitaires résistants qui franchissaient subrepticement les frontières et auxquels nous tendions la main, avec les universitaires souffrant du froid et de la faim et que nous réconfortions. Par ces moyens d’informations, l’Entr’aide est restée ouverte à tous les courants de la pensée universitaire; par sa volonté intense de sympathie elle s’est maintenue en communion de pensée avec les étudiants engagés. Lorsque l’atmosphère était lourde en Europe, l’atmosphère était lourde au secrétariat de l’Entr’aide universitaire. Lorsque le premier rayon de liberté a filtré à travers le continent, il a également éclairé notre travail; et, aujourd’hui, nous baignons tous dans une même lumière.
Nous avons été les témoins passionnés et anxieux de cet étrange effort collectif qui du peuple s’est transmis aux universités, qui, brisant les barrières, a uni catholiques, protestants, communistes, libéraux et socialistes dans cet effort extraordinaire qui a libéré le monde avant de le transformer. Au seuil d’une paix encore fragile, cet effort cependant semble hésiter comme aveuglé par trop de lumière, ou peut-être comme trop fatigué ou comme trop freiné. Pourtant cette volonté commune d’aboutir coûte que coûte à un renversement a été la manifestation la plus féconde, la plus riche en espérances de cette guerre. Si cet effort venait à trébucher· dans la paix comme une corde qui cède à une traction violente, l’Université occidentale n’aurait que des perspectives étroites de renouvellement.
II est devenu un lieu commun de parler de crise de l’Université. Nous essayerons toutefois d’en éclairer certains aspects à la lumière d’une assez longue expérience. Pour fixer les idées nous dirons que la crise de l’Université a été due au fait que l’Université n’était pas engagée. Elle n’était pas engagée socialement c’est à dire qu’elle ne plongeait pas ses racines dans la société tout entière; elle n’était pas engagée politiquement, parce qu’elle considérait les querelles du siècle avec indifférence; elle n’était pas engagée organiquement c’est-à-dire qu’il n’y avait plus de communauté universitaire: et elle n’était pas engagée internationalement, car en devenant nationaliste. elle faillissait à une tradition millénaire.
Lorsque nous parlons de l’absence d’engagement social de l’Université, nous entendons qu’elle n’était pas démocratique, qu’elle ne nourrissait pas de science et de culture le meilleurs fils de la nation, mais qu’elle dispensait un enseignement formel à des privilégiés. L’Université a été, dès le début du 19e siècle, la place forte de la bourgeoisie, elle en a connu l’ascension la grandeur, elle en connaît tous les avatars et toutes les déchéances. Il est vrai que des bourses atténuaient le caractère anti-social de l’Université; elle n’en était pas plus démocratique, pas plus que la pairie n’est démocratique, quoique de simples roturiers puissent être élevés à cette dignité. Au contraire des jeunes gens de classe modeste n’accédaient pas à l’Université comme représentants de leur classe mais plutôt comme des transfuges anxieux de « bourgeoisisme ». Le résultat de cet état de choses a été une sélection médiocre, un enseignement qui s’écartait volontairement de la vie et un ennui de plus en plus grand au sein de l’Université en marge de la société. Ce caractère immobile de l’Université de 1939 ne pourrait être transformé que si l’effort démocratique pouvait transformer la société tout entière, sinon, selon le mot de Garaudy**, « l’intellectuel serait voué au doute, à la solitude et au désespoir ». L’Université n’est pas une réalité en elle-même mais le reflet d’un ordre social.
Nous employons si souvent le mot de démocratie, que nous nous voyons dans l’obligation de le définir une fois de plus. Toute conception politique repose sur une philosophie de l’histoire. La conception démocratique dit : l’histoire n’est pas une suite de hasards, l’histoire n’est pas l’objet de forces mystérieuses mais de forces connaissables répondant à des lois, car elle est déterminée par la volonté collective des peuples reposant sur les conditions de vie économique et sociale de leur temps. Cette direction pré-déterminée de l’histoire est en même temps la direction de la justice, car il est évident que la volonté collective des peuples, dans la mesure où elle peut s’exprimer sans entrave, tend à une vie libérée de la crainte et libérée de la misère. La grandeur de l’homme réside dans le fait qu’il peut influer sur le cours de l’histoire, soit en le précipitant, soit, par un effort violent et contre nature, en le faisant sortir de son lit.
C’est ainsi que la pensée démocratique rejoint la tradition de l’humanisme qui dit avec Pic de la Mirandole*** « De la grandeur de l’homme : Nous ne t’avons donné, Adam, ni une demeure déterminée, ni une figure qui te soit propre, ni une fonction spéciale, afin que tu puisses avoir à ton choix la demeure, la figure, la fonction que tu souhaiteras. Je t’ai placé au milieu du monde pour que tu puisses plus aisément regarder autour de toi dans le monde. Nous n’avons fait de toi ni un être céleste, ni un être terrestre, ni un immortel ni un mortel, afin que tu puisses modeler, façonner toi-même comme un sculpteur la forme que tu préféreras te donner. Tu pourras tomber au rang inférieur des brutes ou t’élever au rang supérieur des êtres divins ».
La liberté dont parle Pic de la Mirandole est devenue illusoire dans une société en proie à des contradictions internes, où des milliers de gens luttent pour ne pas mourir de faim. Devant cette réalité, l’Université bourgeoise s’est rebiffée, refusant de la considérer. Les économistes se sont plongés dans des statistiques ; les philosophes se sont réfugiés dans les nuées ; les juristes sont devenus les techniciens d’un droit immobile et même les artistes ont cherché des évasions surréalistes. Seuls les hommes de science transcendaient parfois les barrières établies, à moins qu’ils ne fabriquassent des machines de mort.
Comme le dit encore Garaudy, « la pensée a besoin de se heurter à des résistances et de les vaincre, de saisir, de prendre et de comprendrel es choses. La pensée n’existe que rnilitante et constructive., elle n’est sûre de sa vérité que lorsqu’elle en constate l’efficacité. En l’isolant du monde, elle fait de l’intellectuel un être à part, elle le rend étranger dans son ciel d’idées pures aux hommes qui ont les mains de travailleurs. » Et encore une fois la pensée récente française nous montre le chemin. Dans le manifeste de l’Encyclopédie de la Renaissance française nous trouvons ces mots d’ordre: « Nous voulons unir l’intelligence et le travail », « Nous voulons replonger l’intellectuel dans le terreau humain. » C’est ainsi que l’intellectuel reste en contact avec la tradition de l’humanisme.
Lorsque nous disons que l’Université n’était pas engagée politiquement, nous entendons que, sans réaction propre, elle a participé aux tristes aventures de la bourgeoisie se défendant contre la démocratie et recourant à toutes les formes de dictatures par peur d’une évolution socialiste. Nous n’entendons nullement, par contre, que l’enseignement doit être politique ; au contraire, nous maintenons que la recherche libre et désintéressée de la vérité doit rester le fondement glorieux et intangible de l’Université. Mais nous sommes d’avis que l’universitaire qui, du fait qu’il se livre aux plus hautes spéculations de l’esprit, jouit dans le peuple d’un prestige souvent excessif, se doit de prendre la parole et de maintenir les traditions qui lui ont permis de se cultiver. Or, sur ce point également, nous pouvons faire la critique de l’Université d’avant-guerre qui s’est bercée dans une prétendue neutralité, dans une pseudo-objectivité. Mais ne nous y trompons pas : ce désintéressement que préconise le droit positif en ne considérant que le texte écrit est une attitude très nettement réactionnaire ; c’est l’attitude de la peur, de la crainte que par l’étude des problèmes de la vie politique, l’étudiant n’aboutisse à un diagnostic non orthodoxe. On a même exclu de certaines universités l’enseignement de toute philosophie matérialiste, quoiqu’elle fût celle de Descartes, Diderot et Claude Bernard. L’université fasciste, elle, est allée jusqu’à s’engager politiquement mais l’on sait comment. Quant au véritable engagement de l’intellectuel, c’est Jean-Paul Sartre qui nous en indique la portée dans un texte récemment publié : « La littérature engagée » ; c’est Voltaire protestant dans le procès Calas ; c’est Zola défendant Dreyfus. (Par contre, Flaubert qui aurait pu empêcher la répression qui a suivi la Commune en intervenant dans la controverse s’en abstint.) Cette nécessité de l’incarnation sociale est également évoquée par l’écrivain américain Carl van Doren qui parle dans un récent congrès des « mains sanglantes qui frappent, des mains cyniques qui laissent frapper, des mains sordides qui profitent de la misère humaine ».
Lorsque nous disons que l’Université n’était pas engagée organiquement, nous entendons qu’il n’existait souvent pas de communauté entre étudiants et professeurs. Tous ceux qui ont part aux choses de l’esprit doivent avoir le sentiment de collaborer à une grande entreprise commune. Les professeurs doivent collaborer dans l’esprit des étudiants et les étudiants apporter aux professeurs leurs enseignements. Or, nous n’avons jamais connu que la hâte des professeurs d’aller gagner de l’argent hors de l’Université et la hâte des étudiants pour terminer leurs études et gagner de l’argent. Là aussi la guerre a apporté un renouvellement et nos amis hollandais ont élaboré dans la résistance des projets très concrets de Civitas Academica.
Lorsque nous avons dit que l’Université n’était pas engagée internationalement, nous rappelions le fait que la science ne peut être qu’internationale, mais qu’au contraire un nationalisme absurde a détourné l’attention des savants des problèmes essentiels de la recherche humaine pour les asservir à une politique de racisme, à une politique de préparation à la guerre. Combien étions-nous loin en 1939 de l’état d’esprit d’Engels qui écrivait en 1890 : « l’histoire des sciences qui est universelle est l’histoire de l’élimination progressive de l’erreur, c’est à-dire, de son remplacement par une erreur nouvelle mais de moins en moins absurde. »
En faisant le diagnostic de la crise de l’Université, nous nous demandons soudain, est-ce la critique de l’Université d’avant-guerre ou de l’Université d’après-guerre ? II est trop tôt pour répondre à cette question mais une réalité est là : pendant la guerre, l’Université d’abord hésitante, incertaine, souvent lâche, s’est ressaisie, s’est engagée, a triomphé. Il est vrai qu’il y eut en France Carcopino, Chevalier et Bonnard****, qu’il y eut en Hollande le recteur de l’université d’Amsterdam van Dam, qu’il y eut des traîtres en Norvège., en Belgique et ailleurs. Mais il y eut cette résistance dont j’ai parlé au début, qui a uni toutes les forces constructives, qui est montée de la nation et qui a refusé, au-delà des petites trahisons, la plus grande des trahisons : la collaboration avec les nazis, sauf dans certains pays satellites.
Le refus a été vraiment européen.
Dès novembre 1939, en Tchécoslovaquie, l’occupant ferma toutes les universités, fusilla et déporta nombre d’étudiants, interrompit pendant trois ans tout l’enseignement supérieur. En 1939 aussi, toutes les universités de Pologne furent fermées inexorablement et l’ « intelligenzia » polonaise déportée. Dès 1940, c’est la résistance dans toute l’Europe, qui se déroule en trois étapes. 1940-1941, c’est l’exclusion des juifs de l’Université. L’université de Leyde, la plus vieille et la plus glorieuse université de Hollande préfère fermer ses portes; l’université libre de Bruxelles plutôt que d’accepter le contrôle étranger suspend son enseignement. 1942, c’est l’expédition au travail obligatoire en Allemagne. Déjà de nombreux étudiants disparaissent dans l’illégalité. En 1943, c’est la résistance ouverte et le refus de prêter le serment
d’allégeance au Reich. En Hollande, seulement 15% des étudiants cèdent et à Oslo, on doit recourir à des déportations massives, de même qu’à Athènes. En Italie, le recteur de Padoue lance un appel désormais célèbre et même en Allemagne, des étudiants de Munich manifestent contre le nazisme et sont fusillés. 1944, c’est la participation des étudiants au coup de feu en France, en Yougoslavie et ailleurs, où ils organisent les maquis. Puis ils libèrent avec leur ville leur université à Paris, à Vienne, à Budapest où beaucoup d’universitaires sont morts sous les fenêtres mêmes de leurs hautes écoles. Deux jours avant notre départ pour cette conférence, nous avons reçu un message d’étudiants viennois nous demandant d’hospitaliser en Suisse un groupe d’étudiants blessés dans des combats de rues contre les SS. Partout, une presse universitaire clandestine fleurit, c’est L’Université libre en France, le Degeus en Hollande. Et souvent les étudiants devancent les professeurs dans leur attitude.
Aujourd’hui, nous sommes arrivés à un de ces rares moments historiques, où le sort de l’Université est entre les mains des étudiants. Au lendemain de la guerre, les conditions politiques fluides permettent, si on saisit l’occasion, des réformes profondes. Là encore le mot de Pic de la Mirandole reprend toute son actualité, que « l’étudiant peut façonner et modeler lui-même, comme un sculpteur, la forme qu’il préférera donner à l’Université ».
L’Entr’aide universitaire internationale s’efforcera d’apporter sa petite contribution à cette grande tâche.
Edmond FERENCZI.
Notes
*Edmond Imre Ferenzi né à Vienne EN 1920 de parents hongrois est élevé en Suisse. Il est employé depuis 1942 par l’international Student Service, et devient en 1947 secrétaire du Fonds européen de secours aux étudiants (FESE). Il retourne ensuite en Hongrie pays qu’il va représenter durant de longues années à l’Unesco.
** Garaudy Professeur de philosophie adhère au PCF en 1933. Ce parti le met en avant Après guerre comme figure de l’intellectuel marxiste alors plutôt orthodoxe et dogmatique.
*** Pic de la Mirandole philosophe italien du 15e siècle pris comme modèle de l’intellectuel européen
**** Jérôme Carcopino, Jacques Chevalier et Abel Bonnard ont été chargés de l’Instruction publique dans les gouvernements de Vichy.