-
AGENDA
Fév28sam14 h 00 min La 4e internationale et « la rad... @ La contemporaineLa 4e internationale et « la rad... @ La contemporaineFév 28 @ 14 h 00 min – 18 h 00 min Journal du secteur lycéen de la LC et des cercles rouge lycéens, février 1971 samedi 28 à 14 h à La contemporaine. Robi Morder (Germe, chercheur associé au laboratoire printemps (UVSQ Paris Saclay), membre du[...]
Journal du secteur lycéen de la LC et des cercles rouge lycéens, février 1971 samedi 28 à 14 h à La contemporaine. Robi Morder (Germe, chercheur associé au laboratoire printemps (UVSQ Paris Saclay), membre du[...] CHAINE YOUTUBE DE LA CITE
SEMINAIRES
COLLOQUE 2021 2022 SPORT UNIVERSITAIRE
Catégories
- appel à contributions
- archives et mémoires
- axes de recherche
- cahiers du germe
- collection germe aux éditions Syllepse
- dans d'autres éditions
- dictionnaire biographique et prosopographie
- internationale
- La lettre électronique
- mouvement étudiant et jeunesse
- mouvement étudiant et milieu étudiant
- mouvement, étudiant, mouvements sociaux et société
- mouvements étudiants et institution universitaire
- Non classé
- notes de lecture
- séminaires
- vie du germe
Étudier les mouvements étudiants
L’Université de Padoue de la fin de la guerre à la contestation soixante-huitarde. Colloque des 24 et 25 septembre 2015
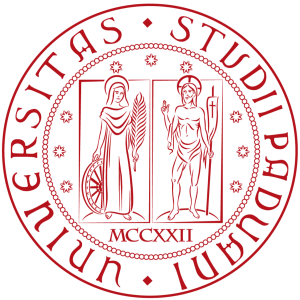 Padoue, la deuxième université italienne par année de fondation (1222) après Bologne (1088), est l’une des institutions d’enseignement supérieur les plus anciennes au monde. Au sein de son département d’Histoire[1], un laboratoire spécialisé – le « Centro per la storia dell’Università di Padova », actuellement dirigé par le professeur Alba Lazzaretto – a été créé dès 1922 pour préserver l’extraordinaire patrimoine archivistique qu’elle possède et pour interroger ses sept premiers siècles d’existence.
Padoue, la deuxième université italienne par année de fondation (1222) après Bologne (1088), est l’une des institutions d’enseignement supérieur les plus anciennes au monde. Au sein de son département d’Histoire[1], un laboratoire spécialisé – le « Centro per la storia dell’Università di Padova », actuellement dirigé par le professeur Alba Lazzaretto – a été créé dès 1922 pour préserver l’extraordinaire patrimoine archivistique qu’elle possède et pour interroger ses sept premiers siècles d’existence.
A l’aube du huitième centenaire de création de l’université, l’attention des chercheurs du laboratoire s’est progressivement portée sur l’époque contemporaine, interrogeant d’abord la contribution des étudiants padouans à l’unité d’Italie[2], puis la place de la pensée positiviste entre le XIXème et le XXème siècle[3] et, enfin, le processus de massification scolaire engagé après la Deuxième Guerre mondiale. Ce dernier thème a fait l’objet d’un colloque – « De l’Université d’élite à l’Université de masse. Padoue de l’après-guerre à la contestation soixante-huitarde » – qui s’est tenu dans le prestigieux Palais du Bo, le bâtiment historique de l’université, les 24 et 25 septembre 2015, dont nous rendrons compte dans cet article.
Avant, il est néanmoins indispensable de livrer quelques éléments de contextualisation historique indispensables au lecteur français. Les années 1945-1968 se caractérisent, en Italie, par un processus inédit de reconstruction institutionnelle et économique : après 20 ans de fascisme et presque un siècle de monarchie, l’adoption de la République (1946) et d’une nouvelle Constitution (1947) semblent témoigner de l’unité des principales forces issues de la Résistance, le Parti Communiste Italien (PCI) et la Démocratie Chrétienne (DC). Les élections législatives de 1948 sonnent le glas de la cohésion, laissant entrevoir les premiers signes de la « guerre froide » ; dirigée par un gouvernement DC, l’Italie bénéficie pleinement de l’aide du plan Marshall et connaît, au cours des années 1950, un véritable « miracle économique ». L’industrialisation rapide du pays et sa modernisation s’accompagnent de plusieurs processus complémentaires : une urbanisation vertigineuse, un exode rural massif, un phénomène d’immigration intérieure du sud vers le nord de la péninsule, un accès étendu à la consommation, sans oublier une explosion démographique – ou baby boom – comparable à celle des autres pays occidentaux. Si ces éléments semblent en mesure de fournir une première explication autour de la massification des effectifs à l’Université de Padoue dans la période qui nous intéresse, deux autres points doivent être évoqués.
D’abord, l’immobilisme institutionnel singularisant le système universitaire italien depuis la fin de la guerre jusqu’en 1968 : la structuration des universités ne change pas, dans les faits, de celle fasciste, sinon par l’introduction d’une assemblée représentative étudiante ayant peu de pouvoirs (l’UNURI, déclinée localement dans des organismes associatifs appelés les « petits Parlements »[4]). Des réformes ne sont proposées qu’à partir du milieu des années 1960, quand un nouveau gouvernement de « centre-gauche » (DC – Parti Socialiste) tente d’introduire une refonte des diplômes, échouant cependant face à l’opposition quasi-unanime[5] des Recteurs[6], des professeurs et des étudiants. Ces derniers, à l’automne 1967, commencent d’ailleurs à contester l’institution universitaire, exprimant tout d’abord des revendications matérielles (libéralisation définitive de l’accès à l’enseignement supérieur, instauration de logements étudiants, etc.) avant de remettre en question les rapports pédagogiques et leur système de représentation, qui éclatera complétement au lendemain de 1968 au profit des Assemblées Générales[7].
Le deuxième point est lié aux particularités locales de Padoue : ville universitaire au cœur des Vénéties, Padoue n’est pas moins un lieux de pèlerinage (sanctuaire de Saint-Antoine) ayant une tradition catholique séculaire. De ce fait, Padoue se présente comme une réalité très conservatrice, bénéficiant de surcroît d’une extraordinaire stabilité institutionnelle pendant toute la période qui nous intéresse : de 1949 à 1968, la ville a connu « un seul recteur, un seul maire et un seul évêque »[8], tous du même bord politique, la DC. En 1967-1968, la donne change brutalement, du moins dans le milieu universitaire : l’incapacité du Recteur Guido Ferro à faire face aux occupations du Palais du Bo le contraignent aux démissions[9]. A peine nommé, le nouveau Recteur, Enrico Opocher – censé être plus libéral que le précédent – est confronté à une radicalisation du mouvement étudiant, qui se traduit par l’éclatement d’une bombe dans son bureau en avril 1969[10]. Padoue deviendra ainsi, au cours des années 1970, un véritable foyer de contestation révolutionnaire. Mais cette époque dépasse les limites chronologiques établies par les organisateurs du colloque, auquel il convient de revenir.
Dans son rapport introductif, le professeur Pietro Del Negro (Université de Padoue) situe l’histoire longue de l’institution, à partir de sa création jusqu’à l’après-guerre. Si Padoue n’a formé que ponctuellement des « élites » au sens de « classe dirigeante », son fonctionnement a été en revanche toujours « élitiste », les effectifs de l’Université restant stables (1000-1500 étudiants) jusqu’aux lendemains de la Première Guerre mondiale. Un début de massification peut être observé à partir de l’époque fasciste : dans les années 30, le régime, conformément à son slogan « aller vers le peuple », essaie de promouvoir l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur, doublant le nombre d’inscrits à l’université. Il faudra cependant attendre la fin des années cinquante, puis les années 1960-1970, pour qu’on puisse réellement parler d’une « université de masse ».
A partir de ces derniers éléments, le professeur Mario Moretti (Université de Sienne) tente de situer Padoue dans le panorama des universités italiennes de l’après-guerre. Si, comme nous l’avons vu, le système universitaire de la Libération est fondamentalement identique à celui fasciste, chaque université essaie de s’attribuer des marges de manœuvre dans trois grands « vides » laissés par la Loi : le vote du budget, l’institution de nouvelles facultés et l’articulation territoriale. Padoue n’échappe pas à cette logique : des discussions budgétaires sont tout d’abord engagées par le Recteur Guido Ferro avec les élus démocrates-chrétiens, parvenant à dégager des fonds pour créer des nouvelles facultés – agronomie, économie et commerce, etc. – non seulement dans Padoue elle-même mais également dans d’autres centres de la région (Vérone, Legnaro etc.)[11]. Cette diversification de l’offre conduit automatiquement, par un effet de levier, à l’augmentation du nombre d’inscrits à l’université.
Le professeur Alba Lazzaretto (directrice du « Centro per la storia dell’Università di Padova ») prend la parole à son tour pour présenter le contexte padouan entre 1945 et 1968 à partir de trois éléments : l’institution universitaire elle-même, voyant une multiplication des formations (on passe de 17 en 1945-1946 à une trentaine en 1968-1969) ; le corps enseignant, qui augmente constamment depuis la première moitié des années 1960 (ouverture de plusieurs dizaines de postes par an) ; les effectifs étudiants, enfin, qui « explosent » littéralement en l’espace d’une décennie (1958-1968). Selon Alba Lazzaretto, ce « tsunami démographique » est en mesure d’expliquer, du moins partiellement, le malaise conduisant aux occupation de l’hiver 1967-1968 : d’une part, un tiers environ des étudiants padouans est « fuori corso », c’est-à-dire hors des délais normaux d’obtention du diplôme[12]; de l’autre, l’université compte plus de 700 « assistants volontaires » – sortes de « chargés de TD » à l’italienne – qui, en l’attente d’une titularisation, assurent des enseignements sans percevoir aucun salaire. Nous sommes donc en présence d’un « réservoir d’atteintes » vis-à-vis de l’institution qui conduira aux évènements des « années 68 » évoqués auparavant.
Le professeur Vittorio del Piaz (Université de Padoue) clôture enfin la première matinée du colloque par une intervention sur l’urbanisme universitaire. Les nombreux dégâts subis par le Palais du Bo et les autres bâtiments de l’université pendant la Deuxième Guerre mondiale amènent les Recteurs Egidio Meneghetti (1945-1947) et Aldo Ferrabino (1947-1949) tout d’abord à rechercher des locaux pour accueillir provisoirement les étudiants, puis à engager d’importants travaux de rénovation. A partir du Rectorat de Guido Ferro, l’université se lance dans la construction immobilière[13]; les nouveaux bâtiments se révèleront cependant insuffisants face à la hausse d’effectifs des années 1960.
La première après-midi est ouverte par une intervention de Maria Silvia Grandi (docteur en Philosophie) portant sur la place des femmes à l’université. Padoue revendique la première étudiante au monde à avoir obtenu un diplôme universitaire (Elena Lucrezia Cornaro, 1678) et, pourtant, les femmes restent toujours nettement minoritaires au sein de l’université jusqu’aux années 1950-1960. Le processus de féminisation étudiante qui s’engage alors se répercute plus ou moins faiblement au sein du corps professoral : quelques « assistantes » sont nommées, notamment en médecine ou en sciences dures. Il faudra attendre 1963 pour qu’une femme, Massimilla Ceolin, physicienne de renommée internationale, obtienne une Habilitation à Diriger des Recherches, devenant ainsi la première véritable « professeure » de l’Université… 741 ans après sa fondation.
En reprenant une thématique déjà abordée dans la matinée, le professeur Monica Fioravanzo (Université de Padoue) analyse les liaisons entre l’université et la politique, en se focalisant en particulier sur les professeurs qui deviennent parlementaires entre 1949 et 1968. La composition de l’échantillon reflète globalement l’orientation politique de la ville : la majorité d’entre eux sont issus de la DC (5), suivis du PCI – 3, avec notamment dans leurs rangs la figure de Concetto Marchesi, Recteur éphémère de l’Université en 1943 et l’un des héros de la Résistance locale – et du PSI (1). Ce groupe d’anciens collègues a parfois su dépasser les clivages partisans lorsqu’il s’est agi de débattre au Parlement des questions universitaires, jusqu’à constituer un véritable « lobby des profs », selon les termes de l’intervenante. Cette unité éclate cependant dans les années 1960, quand certains membres de la DC défendent le principe de non-démocratisation de l’Université. L’un d’entre eux, Giuseppe Bettiol, ancien professeur de Droit, prononce même une phrase qui restera relativement célèbre : « la démocratie est avant tout le savoir. Je ne vois pas pourquoi dans les pays dits « socialistes » les étudiants doivent étudier et non pas gouverner, alors que dans nos « démocraties » ils veulent gouverner et peut-être étudier moins ».
L’évocation de l’opposition est-ouest qui clôture l’intervention de Monica Fioravanzo conduit tout droit vers l’exposé suivant, effectué par Benedetto Zaccaria (doctorant en Sciences Politiques) autour de l’importation de la « guerre froide » à l’université. Le jeune chercheur présente tout d’abord le contexte géo-stratégique propre à la ville de Padoue dans les années 1950 : sa localisation près de la Yougoslavie, la présence de nombreux réfugiés des anciens territoires italiens d’Istrie et Dalmatie, l’anticommunisme marqué d’une frange non négligeable de la population, etc. . Il analyse ensuite la « diplomatie culturelle » menée par l’université au tournant des années 1960 : le Recteur Guido Ferro est certes un défenseur convaincu du projet de Communauté Économique Européenne[14], mais il essaie également de reconstruire, à partir du début du processus de « déstalinisation » (1956), des rapports avec les pays du Pacte de Varsovie : en 1961, il entérine par exemple le jumelage avec l’Université de Iaşi (Roumanie), suivi de celui avec Cracovie et Varsovie (Pologne). A la fin des années 1960, Padoue parvient ainsi à jouer un rôle majeur de médiation culturelle entre l’Italie et l’Europe orientale.
Le professeur Giampietro Berti (Université de Padoue) conclut enfin la première journée d’étude en évoquant les changements culturels qui touchent les facultés de sciences humaines à la fin des années 1960. La philosophie marxiste commence à jouer un rôle primordial, certains professeurs parvenant même à consacrer un semestre entier à la pensée du jeune Marx ou à mettre Lénine au programme des révisions pour les examens. L’un d’entre eux, Antonio – dit Toni – Negri, restera d’ailleurs célèbre, contribuant à faire de Padoue un véritable foyer révolutionnaire au cours des années 1970 : fondateur du groupe d’extrême gauche « Potere Operaio » (Pouvoir Ouvrier) et l’un des principaux théoriciens de l’« autonomie » – courant d’inspiration marxiste promouvant l’auto-organisation ouvrière – ce professeur en Sciences Politiques sera accusé de soutenir le terrorisme et devra prendre la fuite en France au début des années 1980. Toni Negri enseignera dans plusieurs établissements français (dont Paris VII et Paris VIII) au cours des années 1980-1990, avant de revenir en Italie dans les années 2000.
Le deuxième jour du colloque est ouvert par l’intervention de Chiara Saonara, chercheuse auprès de l’Institut des Vénéties pour l’histoire de la Résistance. Elle revient en particulier sur le Rectorat éphémère de Concetto Marchesi en 1943 : ce dernier ne reste quelques jours à la tête de l’Université avant de rejoindre la Résistance clandestine. Il parvient néanmoins à inaugurer l’année académique 1943, prononçant un célèbre discours dans lequel il incite les étudiants à prendre les armes contre l’occupant au nom du slogan séculaire de l’université : Universa universis patavina libertas (« pleine et entière liberté pour chacun au sein de l’Université de Padoue »). Son successeur, Giusepe Gola, professeur de botanique proche de la retraite, accepte à contre-cœur la charge de diriger l’université par les allemands ; accusé de collaboration à la libération, il laisse sa place d’abord à Egidio Meneghetti, puis à Aldo Ferrabino, avant que Guido Ferro ne soit élu à la tête de l’institution en 1949.
Le professeur Enrico Baruzzo (Université de Padoue) prend ainsi le relais pour présenter la « longue époque Ferro », qui peut être partagée en deux temps distincts. Dans les années 1950, le Rectorat est marqué par une incroyable stabilité institutionnelle et le consensus quasi-unanime du corps enseignant ; dans les années 1960, avec l’augmentation des effectifs étudiants et le rajeunissement du corps professoral, apparaissent en revanche les premières fissures, qui se termineront par les démissions du Recteur en 1968. Guido Ferro n’a en effet pas su réagir aux occupations étudiantes de l’automne-hiver 1967-1968 autrement que par l’envoi des forces de l’ordre ; des demandes de démissions sont formulées non seulement par le mouvement étudiant mais aussi par un grand nombre d’enseignants dès le printemps 1968. Le Recteur juge inopportun de « donner des signes de faiblesse » à ce moment là : à l’automne, cependant, Guido Ferro est contraint de laisser la place à Enrico Opocher, dans un climat de plus en plus tendu entre les représentants de l’institution et le monde étudiant.
Après avoir écouté le témoignage de l’ancien Recteur – de 2002 à 2009 – Vincenzo Milanesi, portant sur la gestion de l’univerisité durant ses deux mandats, la matinée est clôturée par les interventions de Giulia Simone (docteur en Sciences Politiques) et Giovanni Focardi (professeur de Sciences Politiques) concernant deux facultés padouanes : celle de Sciences Politiques et celle de Droit. Si la première a rouvert ses portes à Padoue en 1948 – les Sciences Politiques ayant été accusées d’avoir été trop compromises avec le régime fasciste qui les a instituées dans les années 1930 – le Droit a en revanche toujours été l’une des branches-phare de l’université. Ces deux facultés partagent quelques caractéristiques communes : tout d’abord, le corps enseignant (les professeurs de Droit Public dispensant souvent des cours en Sciences Politiques, et vice-versa) ; deuxièmement, une augmentation des effectifs étudiants plus faible que dans d’autres départements ; troisièmement, enfin, une opposition marquée entre « laïques » et « catholiques » – touchant à la fois les étudiants et les enseignants – que l’on retrouvera surtout lors des évènements de 1967-1968.
La dernière après-midi du colloque est ouverte par un exposé de Federico Berardinello (Université de Padoue) autour de la goliardia, le folklore étudiant traditionnel, dans l’immédiat après-guerre. Les étudiants de la goliardia[15] padouane ont assez de mal, en 1945, à se restructurer. Ils se heurtent notamment à l’opposition du Recteur Egidio Menighetti, qui les accuse notamment de commettre des violences envers les premières années. Les cérémonies de bizutage et les beuveries en tout genre qu’ils organisent se terminent en effet presque toujours par des plaintes pour des faits plus ou moins graves, allant de l’extorsion d’argent à de véritables agressions physiques ; néanmoins, l’activité de la goliardia dépasse la seule organisation de ce type d’évènements, s’étendant parfois au domaine politique. Ainsi, aux débuts de la guerre froide, les goliardi[16] protestent à la fois contre les anglo-américains et contre les soviétiques – parvenant même à chasser une délégation officielle de chercheurs de l’URSS en visite à l’université – pour demander la restitution de la ville de Trieste, placée alors dans une « zone libre » servant de tampon avec la Yougoslavie, à l’Italie.
Carlo Monaco, chercheur en Histoire spécialisé dans les archives de la police italienne, prend à son tour la parole pour analyser les rapports préfectoraux concernant les étudiants padouans dans les années 1950. A Padoue, le plus souvent, ces rapports comportent la mention « rien à signaler » : les protestations sont peu nombreuses par rapport à celles qui touchent d’autres villes universitaires italiennes (Turin, Bologne, etc.), et la Préfecture préfère souvent taire les quelques évènements contestataires organisés par les associations politiques ou la goliardia. Ce « silence » apparent peut également être expliqué par l’excellent niveau de relations entretenues par les policiers avec les étudiants en général, les goliardi en particulier : ces derniers sont d’ailleurs le plus souvent réprimandés avec une certaine bienveillance par les policiers, donnant rarement suite à des poursuites pénales. La fin de la décennie marque toutefois un changement brutal dans les relations étudiants-policiers : en témoigne une longue relation du Préfet au Ministre de l’Intérieur concernant les protestations à l’Université de Padoue à la suite du massacre de plusieurs ouvriers de la part des forces de l’ordre lors d’un cortège syndical à Reggio-Emilia, en juillet 1960.
Adriano Mansi, doctorant auprès de l’Université de Rome-Tor Vergata, montre dans son exposé les changements qui affectent le « petit Parlement » de l’Université de Padoue – l’association dite « il Tribunato », membre de l’UNURI – au cours des années 1960, pour conduire enfin à sa dissolution en 1968. Le Tribunato se compose de trois branches : l’une concerne la représentation des étudiants proprement dite, la deuxième l’entraide (échange des cours, logement, etc.) et la troisième la goliardia. Les rapports entre ces trois segments sont assez complexes et ils connaissent une inflexion à partir de 1965. La politisation progressive des étudiants padouans amène en effet les membres de l’association à proposer d’abord une refonte des statuts – essayant de marginaliser les activités de la goliardia – puis à tenter de dialoguer avec le mouvement étudiant naissant à la veille de 1968. Malgré un referendum interne proclamant la naissance du nouveau Tribunato, voyant un discret taux de participation au sein de l’université (24%), cette association s’auto-dissoudra en 1968 pour laisser la place aux Assemblées Générales.
Paola Caldognetto, docteur en Histoire, clôture le colloque en examinant le « moment 68 » et la fin de la goliardia. Se basant sur un corpus d’entretiens, elle explique tout d’abord le fonctionnement du « vieux » système : pour être élu « tribun » – président de la goliardia locale – il faut posséder un certain nombre de caractéristiques – être étudiant en médecine, ne pas avoir passé l’examen d’anatomie, porter la barbe, ne pas être blond, etc. – et résister à de multiples provocations – allant des bousculades aux tentatives de kidnapping. Une fois élu « par K.O. », le tribun reste en charge un an et il devient une petite célébrité locale ; ce folklore fait l’objet de vives critiques de la part des étudiants politisés qui considèrent la goliardia comme un mélange de pratiques anachroniques, sexistes et contre-révolutionnaires. En 1967, les membres de la goliardia sont ainsi sommés de choisir entre engagement politique et festif ; la plupart d’entre eux opteront pour la deuxième solution, même si les occupations de 68 verront la présence de quelques étudiants qui refusent de choisir entre participation au mouvement et folklore.
Le colloque se termine ainsi par un débat, dans lequel de nombreux anciens goliardi présents dans la salle témoignent de leur expérience.
En conclusion, les journées d’étude « De l’Universté d’élite à l’université de masse. Padoue de l’après-guerre à la contestation soixante-huitarde » nous apportent non seulement des renseignements historiques précis – et précieux – sur la réalité padouane, mais également sur toute une série de processus – augmentation des effectifs, féminisation relative, rapports entre corps enseignant et étudiants, etc. – touchant l’université italienne dans son ensemble à une époque-clé pour comprendre la situation actuelle. Elles ouvrent ainsi d’intéressantes perspectives de comparaison avec le contexte français de l’avant-68 – malgré de nombreuses spécificités propres à chacun de ces pays, telles le rôle différent de l’Unéf et de l’UNURI ou l’impact de la décolonisation algérienne dans la politisation des étudiants français – qui méritaient d’être approfondies ultérieurement.
[1] Correspondant à une UFR en France.
[2] Faisant l’objet d’un colloque en 2011.
[3] Colloque « Le positivisme à Padoue entre hégémonie et contaminations (1880-1940 )», 2013.
[4] Les organisations composant l’UNURI sont, pour la plupart, liées aux principaux partis politiques issus de la Libération ; ainsi, le rôle des assemblées locales a été assimilé à celui de « petits Parlements » représentant les étudiants… Même si les pouvoirs de ces organismes restent limités, comme nous le verrons avec l’exemple du Tribunato, le « petit Parlement » de Padoue.
[5] Même si pour des raisons totalement différentes, les uns souhaitant conserver la structuration traditionnelle, les autres contestant le manque d’ouverture vers les classes populaires.
[6] Correspondant aux Présidents d’Université en France.
[7] Remplaçant l’UNURI et les « petits Parlements ».
[8] Selon les mots du professeur Mario Moretti au cours du colloque.
[9] Nous y reviendrons infra.
[10] A laquelle Enrico Opocher échappera, n’étant pas présent sur les lieux à ce moment là.
[11] Portant cependant le label « Université de Padoue ».
[12] L’université italienne ne prévoyant pas un redoublement global mais en fonction de chaque examen, que l’étudiant peut repasser dans des « sessions » ouvertes à des intervalles réguliers.
[13] Non seulement dans Padoue mais aussi en dehors de la ville, en faisant construire par exemple le centre universitaire estival de Bressanone, au Trentin Haut-Adige.
[14] L’ouverture du centre estival de Bressanone, tout près de l’Autriche, témoigne par exemple de la volonté du Recteur de nouer des contacts avec les pays germanophones.
[15] Forme d’associationnisme étudiant interdite sous le fascisme.
[16] Adjectif désignant les membres de la goliardia.
Posted in internationale




